HISTOIRE D'UNE ENFANCE ABIMEE PAR LES SERVICES SOCIAUX.
Ces lignes vous sont dédiées, Benoit et Maëva, mes petits anges, sacrifiés comme tant d'autres, au bon plaisir des services sociaux, ainsi qu'à tous ceux dont l'enfance a été bafouée. Je vous offre ce témoignage sur les quelques années d'enfance que j'ai connues de vous. Maëva, tu ne t'en souviens pas ou très peu, chez nous tu es arrivée tu étais encore un bébé, et toi Benoit, tu ne nous as pas oublié, tu étais toi aussi tout petit, deux ans de plus que ta sœur, tu venais d'avoir 4 ans, la veille de ton arrivée. Maëva, tu étais une petite princesse pour nous et Benoit, seul garçon au milieu de 3 filles, notre petit chouchou.
LA PASSIFLORE
Récit d'un destin brisé par les services sociaux.
A Benoît et Maëva.
A mes petits-fils qui baignent dans l’amour.
A tous les enfants abandonnés, bafoués, rejetés, un jour ils auront l’amour...
AVANT-PROPOS
PAR LAURENCE WITKO
" Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous." (Paul Eluard)
Si l'on y réfléchit bien, toutes les rencontres de notre vie se font par hasard, et pourtant, certaines s'apparentent à de véritables rendez-vous.
Ce livre est une histoire de rencontres, de destins qui se sont croisés de façon inopinée... par ce hasard, qui met sur notre chemin des personnes, des situations et des circonstances, et qui orchestre minutieusement et savamment au cours du temps, dans un chaos apparent, les éléments d'un puzzle qui ne découvre sa cohérence et sa finalité qu'au moment opportun.
Emma et moi, nous sommes rencontrées par hasard, au détour de clics improbables. Intuitivement peut-être savions-nous dès le départ que nous avions quelque chose à partager, à nous transmettre mutuellement.
La première fois qu’Emma m'a parlé de son envie d'écrire ce livre d'après le bref récit qu'elle en avait déjà fait, je l'ai vivement encouragé à aller au bout de son désir, et lui ai apporté le soutien et la modeste contribution que j'ai pu.
Mais c'est seulement quand le livre a été terminé que j'ai compris la vraie raison pour laquelle ce livre devait être écrit. Et cette raison essentielle n'est pas de dénoncer en quoi que ce soit un système ou même l'abjection humaine. Non. Il m'apparait qu'il y avait une raison beaucoup plus importante humainement : un autre rendez-vous avait été noté sur le grand calepin de la vie et par le hasard de ces croisées de destins, c'était les retrouvailles d’Emma et des enfants que ce projet a permis de concrétiser.
" On garde toujours quelque chose de l'enfance, toujours." (Marguerite Duras)
Même si nous commençons rarement par "Il était une fois..." pour raconter notre vie, nous avons tous un contexte "historique", qui nous situe dans un espace-temps et qui soutient la personne que nous sommes devenus, autant par les expériences que nous avons vécues que par les personnes qui ont participé à notre "construction".
Cette période de construction évoque pour certains le temps heureux de l'insouciance, pour d'autres, elle est empreinte de beaucoup d'ombre... Nous n'avons pas le pouvoir de choisir le départ que nous donne la vie. Nous commençons par naître avant de connaître...
L'enfance laisse nécessairement des traces ancrées en nous, et l'on ne peut pas changer le passé, même quand nos souvenirs le déforment, volontairement ou inconsciemment, ou que ceux-ci semblent avoir disparus en partie ou en totalité.
Il reste toujours quelque chose de l'enfance, parce que nous sommes des êtres humains et non des ordinateurs, et que l'on ne peut pas formater notre mémoire ou la vider des données antérieures enregistrées d'un "Clear Screen". C'est sur les fondations de l'enfance que l'on bâtit l'assise de sa vie et l'ossature de sa personnalité.
Un enfant n'est pas un être "en devenir", il est déjà un être "à part entière", que ceux qui l'entourent sont chargés d'accompagner et de protéger jusqu'à ce qu'il puisse seul, porter la responsabilité de sa vie, de ses actions et de ses décisions.
Dans un système d'éducation déparentalisé, on demande au professionnel de prendre le dessus sur l'émotionnel, sans bien se rendre compte que c'est d'abord par l'immédiateté de l'émotion et de la sensation qu'un enfant découvre le monde avant de pouvoir le raisonner et le rationaliser. Ainsi, à un univers déjà privé du repère personnel parental, on ajoute une déshumanisation en arguant de toute bonne foi, qu'on agit dans l'intérêt du bon développement de l'enfant...
" Je suis toujours le même que je gagne ou que je perde." (Jerry Minchinton)
Il faut savoir différencier la personne, son engagement, sa capacité d'action et de réaction, des retours qu'elle en reçoit. Même si nous avons tous, indéniablement, une part de responsabilité dans nos actions, il y aussi d'autres facteurs qui contribuent à nos réussites et à nos échecs, dont certains sont complètement indépendants de notre volonté. Sans courage, sans audace et sans volonté d'entreprendre ou de changer l'état des choses, on reste à la merci des coups du sort, comme des spectateurs passifs. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on déploie des trésors de persévérance et de détermination que l'on voit forcément ses efforts immédiatement récompensés et qu'on aboutit au résultat escompté tel qu'on l'avait projeté.
On ne peut pas juger de la valeur d'une personne, uniquement sur les résultat qu'elle obtient, parce qu'on reste la même personne dans nos victoires comme dans nos échecs.
Le mythe de David contre Goliath a ses limites, et parfois, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, on est mis hors-jeu, momentanément KO et contraints d'abandonner le combat.
Les sentiments d'injustice et d'impuissance sont les plus difficiles qui soient à éprouver, mais ils sont passagers : il est rare que la vie ne nous offre pas, à un moment ou à un autre une opportunité de revanche.
" Tout arrive toujours au moment opportun."
Ma philosophie personnelle est que "tout arrive toujours au moment opportun", et que même si l'on ne comprend pas toujours dans l'intensité de l'instant, le sens des choses et des évènements qui nous bousculent, il faut les accepter tels qu'ils sont, les réponses à nos incompréhensions finissent toujours par se frayer un passage pour éclairer notre chemin.
Loin d'être fataliste, cette façon d'appréhender les évènements, les circonstances et l'existence se base sur une confiance quasi aveugle en ce que la vie ne nous met pas sadiquement à l'épreuve, mais qu'elle nous fait sans cesse grandir.
C'est cette confiance-là qui permet de trouver la force de traverser les passages plus difficiles que nous rencontrons tous au cours de notre voyage sur terre...
Passé 18 ans, on n'emploie plus le verbe "grandir" mais le verbe "vieillir" comme si notre temps d'apprentissage avait une durée limitée et déterminée... mais la vie, jusqu'à la fin n'est qu'un long chemin d'apprentissage, et l'on grandit à tout âge grâce à ces épreuves qui nous donnent l'occasion de nous dépasser.
Nos échecs sont toujours une sorte d'antichambre de nos victoires, et la saveur du triomphe relègue vite les amertumes du chemin à un passé qu'on ne veut pas ressasser éternellement, parce que la vie, elle est toujours devant... et le meilleur reste à venir.
PREMIERE PARTIE
“Comme vous, je crois aux anges, j’en ai dans le ciel, j’en ai sur la terre.” Victor Hugo à George Sand
Ce livre vous est dédié, Benoît et Maëva dont la destinée enfantine fut confiée aux mains des services sociaux. Sur le fil de ce destin, vous pouviez basculer du côté bonheur mais des hommes et des femmes sans âme vous ont poussés côté malchance. Pourtant, il aurait suffi de presque rien pour que vous ayez la chance de grandir dans la chaleur d’un foyer affectueux. Qu'un seul parmi ceux dont dépendait votre sort, ait ouvert son cœur, son esprit, sa conscience ou simplement son bon sens, et vous auriez pu être des enfants comme les autres.
Ce récit retrace le parcours de ces deux enfants mais aussi de ces jeunes adolescentes, orphelines ou délaissées par leur famille, qui furent livrées en pâture à ceux qui les avaient recueillies et qui étaient chargés de veiller sur elles. Dans ce lieu de vie où elles pensaient refaire surface, oublier les tourments d’un passé qui ne leur avait rien épargné, ces jeunes filles fragiles allaient s’agripper à ce nouveau foyer pour ne pas couler. Alors qu’elles croyaient mettre enfin la tête hors de l’eau, un couple les avait précipitées au fond du gouffre, dans les abysses de l’ignominie.
Ces petits enfants et ces adolescentes innocents avaient un point commun : ils avaient mis leur confiance naïve dans l’aide sociale à l’enfance. Bienvenue en Enfer.
Deux petits anges posent leur regard confiant sur le monde : l’arrivée.
I
Flore se concentrait sur l’écran où défilaient ses courriels du jour. Soudain l’un deux attira son attention, et son cœur manqua un battement, puis l’émotion le gagna et il prit un rythme plus rapide : il y avait un message de Benoît. Elle le lut fébrilement et un sourire éclaira son visage.
« Maman, s’écria-t-elle en me rejoignant précipitamment, Maman, j’ai retrouvé Benoît ! »
Je restais interdite ; ma fille m’avait bien sûr informée de ses recherches sur internet, mais je ne m’attendais pas à une réussite aussi rapide. Cette nouvelle était si inattendue que mon esprit perdit un instant la conscience du présent. En une fraction de temps, ma mémoire me renvoya les images et les émotions de cette période lointaine, où j’avais accueilli cet enfant et sa petite sœur Maëva dans mon foyer, les quelques mois de bonheur partagé, la peine lorsqu’on me les avait repris, la souffrance de les savoir ensuite maltraités, et mon combat pour tenter de les sortir de l’enfer dans lequel ils avaient été jetés, tout cela me revint à l’esprit.
Depuis longtemps je n’avais plus de nouvelles de ces enfants que j’avais aimés comme les miens, et voilà que ma fille les avait retrouvés. C’était si soudain, si brutal, que je ne pus retenir mes larmes. Flore me prit dans ses bras : “ Ne pleure pas maman, tout va bien.”
Tout allait bien en effet, ainsi ce bel été 2009 m’apportait ses fruits : après une longue période difficile où j’avais perdu des êtres chers, ma mère, puis mon père, l’été me ramenait un fils et une fille. C’est ainsi que je vécus cette journée, avec au cœur le sentiment que la vie me rendait enfin justice.
Tout avait commencé longtemps auparavant, il y avait presque vingt ans, lorsque Benoît et Maëva arrivèrent à la Passiflore.
La Passiflore, c’est ainsi que nous nommions notre maison dont la façade était couverte de grappes de fleurs mauves et blanches, au parfum délicat, qui donnent de beaux fruits orangés : les fruits de la passion. Nous vivions en pleine nature à l’écart du village, la maison était nichée parmi les pins et les chênes séculaires dans un lieu béni des dieux, au cœur des dentelles de Montmirail en Provence.
Je menais une vie douce et sans entrave avec mon mari et mes deux filles, Jade, qui avait dix-sept ans, et Flore, sa cadette de dix ans. Mais le bonheur ne vaut que s’il est partagé, aussi notre maison vaste et accueillante était souvent remplie de rires d’enfants et de musique. Mes filles avaient de nombreux camarades de leur âge qui venaient jouer chez nous, et mon mari, musicien, réunissait souvent ses amis pour des répétitions et des concerts improvisés. La Passiflore était vivante.
Des animaux peuplaient aussi les lieux, chien et chats vivaient là en harmonie, chacun disposant de son espace vital. Il y avait aussi un âne et un mouton, et même une chèvre qui fit les quatre cents coups pendant quelques temps.
De la maison, on pouvait rapidement se perdre sur les chemins de Provence, parmi les senteurs de thym et de romarin. L’été lorsque la chaleur se faisait trop pressante, nous prenions le frais près du bassin aux poissons rouges qui servait parfois de garde-manger au héron cendré qui nous gratifiait de ses visites.
C’est dans ce havre de paix, qu’arrivèrent un matin d’avril, nos deux petits protégés. Ces deux enfants nous furent confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, car j’exerçais les fonctions d’assistante maternelle. Je ne saurais dire d’où me vins cette vocation, mais j’ai toujours ressenti le besoin d’aider mon prochain. C’est un trait de caractère que j’ai hérité de ma mère, qui avait une empathie naturelle. Et puis, il y eut aussi ces voyages que j’ai faits en Inde dans ma jeunesse, où je fus confrontée à la misère locale. Je me souviens avoir distribué à des enfants démunis, des vêtements et des jouets que j’avais apportés. Les émotions que j’avais alors ressenties devant la joie qu’ils m’avaient manifestée, ont sans doute cristallisé en moi ce besoin naturel de me mettre au service des autres.
Plus tard, alors que mes filles eurent grandi, j’ai senti le moment venu de réaliser le projet qui me tenait à cœur depuis longtemps : accueillir des enfants dans mon foyer. J’entrepris le parcours du combattant pour obtenir l’agrément d’assistante maternelle. L’obtention de cet agrément est très réglementée, et les services de l’ASE passent tout ou presque au peigne fin.
Assistantes sociales, psychologues, enquêtes administratives, nous sommes passés par toutes les étapes, mon mari et moi-même, et l’agrément ne nous fut délivré qu’après une longue période d’attente de près d’un an. Puis finalement, on nous confia notre premier protégé.
II
C’était un petit garçon de sept ans, Geoffrey, qui demeura quelques mois chez nous jusqu’à ce que sa propre mère décide de le reprendre avec elle. Avant son arrivée à la Passiflore, il vivait dans un foyer de l’enfance qui portait le joli nom de « l’arc-en-ciel ». Il y avait été placé plusieurs mois auparavant par son père qui dut suivre en Suisse sa compagne gravement malade. Le frère aîné de Geoffrey fut accueilli par ses grands parents, mais la mère des enfants qui était séparée de leur père, ne souhaita pas prendre son plus jeune fils avec elle.
Les services de l’ASE imposèrent une phase d’acclimatation avant que Geoffrey put s’installer chez nous. Durant cette phase de six semaines, nous rencontrâmes plusieurs fois le petit garçon au foyer de l’arc-en-ciel. Nous nous sommes rapidement apprivoisés et nos visites devinrent pour lui une source de joie. Il comprit très vite qu’il allait bientôt quitter ce lieu impersonnel pour vivre chez nous, et il attendait impatiemment cette délivrance. Ces instants de bonheur étaient néanmoins ternis à chacun de nos départs, car Il ne comprenait pas la raison qui nous interdisait de l’emmener. J’ignore si cette façon de procéder est normale, la seule chose que je sais, c’est que plus tard lorsqu’on nous confia Benoît et Maëva, cela se passa bien plus brutalement.
Geoffrey se lia très vite avec Flore qui avait le même âge, elle était sa compagne de jeu et ils devinrent inséparables. Jade les accompagnait parfois à l’école et ils cheminaient en se tenant tous les trois par la main comme des frères et sœurs. C’était un enfant affectueux et d’une grande gentillesse. Il était toujours de bonne humeur et développait déjà un goût pour l’humour.
Geoffrey et mon mari ont les yeux bleus, et puisque mon mari était aussi le facteur du village, les plaisanteries sur le « fils du facteur » allaient bon train dans le voisinage. Geoffrey s’en amusait et se promenait souvent avec la casquette du facteur sur la tête.
Un week-end sur deux je le conduisais chez ses grands-parents maternels avec lesquels je m’étais liée ; c’était un couple de gens simples et d’une grande bonté. Geoffrey les adorait et lorsqu’il m’arrivait de ne pouvoir l’emmener chez eux, c’était sa chère mamie qui faisait le bonheur de son petit-fils en nous rendant visite à la Passiflore. Ses grands parents lui apportaient l’amour que sa mère ne lui offrait pas, et celui que son père ne pouvait plus lui manifester physiquement à cause de l’éloignement. Il lui téléphonait souvent et Geoffrey me parlait de ce père tant aimé les yeux brillant de bonheur. Il fit une fois le voyage depuis la Suisse pour visiter son enfant à la Passiflore et la joie de Geoffrey fut si vive qu’il saigna du nez d’émotion.
Finalement, après une petite année partagée avec nous, il repartit vivre chez sa mère. Par la suite, j’appris des grands-parents que je visitais toujours régulièrement, qu’elle les empêchait de revoir leur petit-fils ; j’en fus attristée, qu’il était difficile pour certains enfants de pouvoir se partager parents et grands-parents en totale harmonie.
Je l’ai revu neuf ans plus tard, il avait alors dix-sept ans. Je retrouvais en ce jeune homme attachant et plein de vitalité, le souvenir de celui qui fut notre protégé durant dix mois. Il affirma qu’il n’avait pas oublié le bon temps vécu chez nous, ni l’affection que nous lui avions portée. J’avoue que son témoignage m’avait beaucoup émue et réconfortée. Depuis nous sommes restés proches et il est toujours l’ami de Flore.
C’est quelques temps après son départ, que nous furent confiés Benoît et Maëva. Ces deux enfants furent placés volontairement à l’ASE par leur mère qui n’avait pas la possibilité de les élever, mais qui ne rompit jamais le contact avec eux. Avant d’arriver chez nous, Benoît et Maëva vécurent quelques temps chez un couple d’origine espagnole dont la femme, âgée et souffrante, dut se résoudre à se séparer d’eux.
III
Je n’oublierai jamais ce matin d’avril 1993, lorsque les enfants débarquèrent à la Passiflore. Débarquer c’est bien le mot, car leur transfert d’une famille à l’autre se fit dans l’urgence et sans période d’adaptation. Un coup de fil de l’ASE suffit à régler les formalités, et les enfants furent conduits chez nous, accompagnés d’un assistant social, d’une puéricultrice et de leur mère.
On imagine facilement le désarroi vécu par ces petits êtres, ballottés si jeunes d’un lieu à l’autre.
Quelques temps après leur arrivée, je pris l’initiative de les mener en visite chez le couple qui s’était occupé d’eux précédemment ; je pensais ainsi adoucir un peu la transition.
Ce jour rayonnant du 15 avril où Benoît et Maëva arrivèrent, ce sont deux petits soleils qui firent leur apparition dans notre nid. Deux oisillons qui ne demandaient qu'à s'épanouir. Benoît avait fêté la veille ses quatre printemps, et sa petite sœur n’avait que vingt-deux mois. Au contact de ces enfants si jeunes, je compris ce que ressentent des parents adoptifs lorsqu’ils accueillent leurs petits protégés : un amour immense et inconditionnel.
Pour les familles d’accueil en revanche il n’était pas question de se laisser aller à trop de sentiment ; les procédures de l’ASE étaient claires à ce sujet, et nous demandaient de ne pas nous attacher à ces enfants qui ne seraient jamais les nôtres, puisqu’ils ne pouvaient être adoptés. C’est cet aspect du règlement, que mon esprit avait inconsciemment occulté, qui fut plus tard à l’origine de mes déboires.
Benoît était adorable, doux comme un ange, tendre comme un agneau, toujours en quête d’affection et de tendresse. Rapidement il m’appela maman, et au début je tentais de le reprendre en lui disant que je n’étais que sa tatie, mais il ne put jamais s’y faire. C’était sa façon de compenser l’absence de sa mère qu’il voyait si peu. C’était aussi pour cela qu’il m’embrassait à longueur de temps.
Benoît avait gardé de sa précédente famille une façon de parler avec des intonations espagnoles : il était adorable lorsqu’il prononçait le mot piano en plaçant l’accent tonique sur le « a ». Mes filles lui faisaient répéter la phrase : il y a une souris sur le piano, ce qui ne manquait jamais de faire rire tout le monde.
Maëva qui n’était qu’un bébé d’à peine deux ans, demanda plus d’attention et de persévérance. Ses premiers pas dans cette humanité peu accueillante l’avaient rendue rebelle, et elle ne manquait pas de caractère. Elle était têtue et parfois un peu capricieuse comme peuvent l’être les enfants de cet âge.
Ce qui nous étonnait le plus était son refus des signes de tendresse, des câlins et des baisers. J’appris lors d’une visite chez sa famille d’accueil précédente que ces marques d’affections étaient rares, ce qui expliquait sans doute ce désintérêt.
J'appris aussi avec étonnement que Maëva passait des matinées entières dans son lit de bébé, la vieille dame m'expliqua qu'elle n'avait pas de parc pour enfant, et que son mal de dos l'empêchait de soulever et de porter la petite.
Maëva semblait aussi effrayée par l’agitation humaine et le bruit : elle pleura et se débattit la première fois que je tentais de l’emmener au supermarché. Il fallut du temps pour qu’elle accepte de sortir en toute confiance. Ses premiers jours chez nous furent consacrés à la découverte des placards de la cuisine qu’elle ouvrait et refermait sans cesse, s’amusant du plaisir de la découverte dont elle était privée auparavant. Elle se déplaçait à petits pas rapides d’une porte à l’autre et je la poursuivais pour ôter tout ce qui pouvait représenter un danger pour elle.
Elle souffrait fréquemment des oreilles, et je dus l'emmener régulièrement chez l'ORL qui lui avait posé un drain. Il fallait veiller à ne pas faire couler d'eau dans son oreille lors des douches ou dans le bain.
Le plus ennuyeux fut son test BCG qui révéla une primo-infection. Toute la famille dut faire des radios des poumons pour savoir si l'un d'entre nous était porteur de la tuberculose. La famille précédente fut aussi dépistée sans que l'on ne trouve aucun porteur. Les médecins décidèrent donc d’investigations plus approfondies, et pour cela Maëva dut subir de nombreuses prises de sang.
Je crains la vue du sang, mais je l’asseyais tout de même sur mes genoux pour la rassurer. L’infirmier qui s’occupait d’elle était à chaque fois attendri par ses larmes et ne manquait jamais de compenser cette souffrance par une sucette. En somme, je prenais soin d’elle comme je l’avais fait naguère pour mes propres filles.
Benoît, était suivi par une pédopsychiatre qui nous recevait chaque semaine. Durant ces séances, il traçait en s'appliquant de petits dessins enfantins. Les médecins ne révélèrent jamais les résultats de leurs investigations, mais il n’y avait pas besoin d’une grande science pour comprendre qu’il n'avait pas de problèmes psychologiques ; il souffrait simplement d’un manque d’amour maternel, et ce manque avait grandi avec lui depuis sa plus tendre enfance. Benoît n’était pas un enfant compliqué, il était juste perturbé de ne pas avoir sa maman près de lui.
En tout cas, chez nous, il était adorable et gai comme un pinson. Il était notre petit ange et je veillais sur lui du mieux que je le pouvais.
Puis les choses se normalisèrent. Le bonheur était à la Passiflore.
Benoît apprenait à faire du vélo sur celui que sa mère lui avait offert, et rapidement il demanda à retirer les roulettes ; en quelques jours et après quelques chutes, il parvint à évoluer seul, jusqu’à ce que prenant trop d’assurance il me lança en m’apercevant : « regarde maman, je sais faire du vélo tout seul », mais à peine eut-il finit sa phrase qu’il dérapa sur le gravier et finit sa course dans les ronces. Il pleura beaucoup et me demanda de remonter les roulettes, mais finalement après un gros câlin et un peu de persuasion, il enfourcha son vélo pour de nouvelles aventures.
Maëva s'ouvrait à la vie, elle jouait avec le sable, glissait sur le toboggan, s'envolait sur la balançoire en criant. Les petits respiraient la joie de vivre. Ils avaient trouvé un refuge de douceur pour leurs premières années. Nous étions unis comme une vraie famille, et il nous semblait que nous serions allés jusqu'au bout du monde avec eux. Pour eux, pour nous, tout était rose, la vie comme la robe de Maëva, notre petite princesse.
Pour amuser le temps libre les idées ne manquaient pas : visites dans des parcs d'attraction, au village des automates, au zoo de la Barben à côté de Salon de Provence, et aussi régulièrement de belles balades près du lac où les enfants pouvaient patauger et jouer avec le sable sur la plage. Parfois, un après midi à la piscine du village permettait à Benoît et Maëva de se mélanger aux autres enfants et de se sentir heureux d’être comme tous les autres.
Devenir semblable aux autres enfants, n’est-ce pas ce que Maëva recherchait jour après jour ? Parfois avec exubérance comme lors de cette journée au bord de la mer au Grau-du-Roi, où son chahut dans une guinguette lors du déjeuner avait importuné un voisin de table, et ce mauvais coucheur s’en était plaint. L’intolérance des adultes est souvent détestable ; Maëva ne faisait pourtant rien de mal, elle voulait simplement exister dans ce monde dont certain lui refusaient encore l’accès. Mais la médiocrité et la bêtise se payent toujours et quelques instants plus tard, ce nigaud de voisin renversa son verre de vin et cacha sa maladresse comme un gosse honteux.
Ce jour là, les enfants découvraient la mer, mon mari avait pris Maëva sur ses épaules et Benoît courait avec son petit seau sur la longue langue de sable menant au bord de l’eau. Comme ils avaient ri et galopé, poursuivis par les vagues qui leur léchaient les pieds. Je n’oublierai jamais ce moment de joie dans les yeux de mes petits protégés, le bonheur était là, tout simple, à portée de mains.
IV
Tous les quinze jours, je me rendais en Avignon pour assister à divers cours de psychologie utiles à ma formation d'assistante maternelle. Ces séances me permirent de rencontrer d'autres collègues, et de me lier d'amitié avec certaines.
Nous en profitions pour échanger nos expériences et nos points de vue sur notre métier. L’une d'entre elles me confia un jour qu’elle s’était attachée plus que de raison à l’enfant dont elle avait la charge. Elle redoutait que cette situation fût dévoilée et que l’enfant lui fût retiré. J’avais entendu parler de cas semblables où les services sociaux, soucieux de préserver les liens du sang, avaient retiré des enfants qu’ils jugeaient trop proches de la famille d’accueil ; cette fois encore mon inconscient occulta l’information.
Parmi mes collègues certaines regrettaient que notre travail fût mal rémunéré. D’autres comme moi, pensaient que c’était le plus beau métier du monde. Pouvoir élever des enfants, les miens et ceux que l'on me confiait, tout en restant chez moi, était idéal.
En plus de notre rémunération, l’ASE nous octroyait un supplément pour habiller les enfants, mais il était insuffisant et je le complétais souvent, par pur plaisir, pour gâter mes petits et leur acheter des jouets. Il fallut surtout faire le plein de jouets de garçon pour Benoît. Maëva disposait des jouets de mes filles qui peuplaient une pièce de notre maison entièrement consacrée aux jeux.
Elle était trop jeune pour aller à l’école et je l’avais toujours avec moi, dans les bras ou coincée sur ma hanche. Pour moi elle était telle une petite poupée.
Benoît était en âge d’être scolarisé. Ses débuts en classe furent un peu compliqués. Il a fallu lui trouver une place, et tout naturellement je l’inscrivis dans la petite école que fréquentait déjà ma fille Flore, et qui avait aussi accueilli Goeffrey précédemment. L’école était nichée dans un beau petit village suspendu à un piton qui offre au visiteur un magnifique paysage.
C’était un petit établissement d’une dizaine d’enfants encadrés par deux institutrices ; les niveaux allaient de la maternelle à la fin du primaire.
Avec beaucoup de diplomatie, je parvins à convaincre la directrice d’accepter Benoît jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais elle me prévint qu’il me faudrait trouver d’autres dispositions pour la rentrée de septembre. Les institutrices invoquèrent une surcharge de travail ; il est vrai qu’un enfant de maternelle représentait un travail supplémentaire. Elles consentirent néanmoins une dérogation pour les trois derniers mois de l’année scolaire ; mais Benoît ne pouvait être correctement suivi, car chaque niveau demandait une attention particulière et elles ne pouvaient, semblait-il, y faire face. Je dus donc me résoudre à inscrire Benoît dans une école plus importante à quelques kilomètres de là.
Cependant il n’était pas question de déplacer Flore qui était bien intégrée dans son école où elle avait tous ses amis. Ainsi donc deux fois par jour je parcourais la distance séparant les deux écoles pour emmener mes enfants en classe.
Benoît fit la rentrée de septembre dans une nouvelle école. Celle-ci était plus adaptée que la précédente par le nombre d’enfants et de classes. L’institutrice de Benoît était gentille, prévenante et pleine de bon sens. Elle connaissait mon petit problème de logistique, et me permettait de prendre Benoît un peu avant l’heure réglementaire pour me laisser le temps de parcourir le chemin jusqu’à l’école de ma fille; ainsi je pouvais la récupérer sans faire attendre les autres institutrices qui n’acceptaient pas de retard.
La maîtresse de Benoît avait la faculté de rendre la vie de ses prochains moins compliquée et plus douce. C’était une femme intelligente qui aimait son métier et les enfants dont elle s’occupait, et cette qualité se manifestait parfois par de simples mots judicieusement prononcés ; face à Benoît elle me nommait « maman », elle savait pertinemment que je n’étais pas sa mère, mais le soir lorsque je passais le rechercher et qu’il tardait à s’habiller, elle lui disait : « Dépêche-toi Benoît, maman t’attend », elle aurait pu me nommer tatie ou nounou, mais elle employait le mot maman, ce n’était rien qu’un mot mais il avait le pouvoir de rendre Benoît semblable à tous les autres enfants, et cela lui faisait du bien.
Durant quelques temps, la maman des enfants fut hospitalisée et les visites que nous lui rendions le samedi après-midi, un week-end sur deux furent compromises.
Les enfants partagèrent donc durant plusieurs mois notre quotidien à plein temps, et l’attachement mutuel fut inévitable : comment aurait-il pu en être autrement ?
Pendant cette période, tout ce que je fis pour eux contribua à resserrer le lien qui nous unissait. Je jouais mon rôle de mère, car c’est bien de cela qu’il s’agissait ; comment désigner autrement une femme qui s’occupe d’enfants comme les siens, et dont le cœur jour après jour les nourrit d’amour ?
L’ASE ne nous oubliait pas, et nous étions visités chaque mois par l’assistant social référent des enfants. C’était un homme sympathique qui se déplaçait à moto, et qui avait fait de nombreux voyages en Afrique qu’il aimait nous raconter.
Originaire de la région parisienne, il était installé depuis peu en Provence avec sa femme et ses enfants, et il appréciait la qualité de cette nouvelle vie. Puisque tout se passait pour le mieux avec les enfants, ses visites étaient des formalités et pour lui des occasions de balades en moto.
Des valises pleines de larmes.
" Tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer." Charles Baudelaire
V
Il est des jours où le ciel est trop bleu, le soleil trop brillant, l’air trop pur, pour que cela puisse durer ; des jours où la beauté des choses ne suffit pas à cacher la laideur qui pointe le bout de son nez. Mais la vie est ainsi, elle donne mais exige sa part, un prix qu’il faut lui payer pour que nous n’oubliions pas que nous ne sommes ici-bas, que des locataires occasionnels et que ses bienfaits ne sont pas éternels.
C’est ce qui arriva ce matin, où une voix au téléphone m’annonça sans ménagement, qu’on allait me reprendre les deux enfants que l’on m’avait confiés : je compris soudain que le temps du bonheur que nous avions construit ensemble touchait à sa fin.
Il me fallut un long moment pour me reprendre et sécher mes larmes de colère et de désespoir. Mon mari était tout aussi abattu que moi. Tous ces longs mois de bonheur partagé, de joie, de rires, de complicité entre nos petits protégés et ma famille, tout ceci devait prendre fin par décision d’une autorité supérieure qui ne prit même pas la peine de nous l’expliquer.
Je n’ignorais pas, bien sûr, que les enfants devaient un jour nous quitter, mais je n’avais pas envisagé une aussi brève échéance, ni la brutalité de l’annonce de leur départ. Je m’étais investie dans cette activité d’assistante maternelle par amour des enfants, pour leur apporter de l’attention, de l’affection et c’est ce que je faisais, et ma famille avec moi, sans compter, jour après jour, pour Benoît et Maëva. Maintenant on me demandait de préparer ces deux petits au départ, et de leur expliquer une situation que je ne comprenais pas moi-même.
Les consignes étaient simples. Je devais conduire les enfants chez leur mère où ils passeraient le week-end et de là, l’assistant référent les mènerait dans leur nouvelle famille d’accueil.
Je disposais de quelques heures pour réunir leurs affaires et boucler leurs valises, trier les vêtements qu’ils portaient de ceux qui n’allaient plus, et les jouets qui les amusaient de ceux qu’ils avaient abandonnés. Mais comment allais-je annoncer aux petits qu’ils vivaient leur dernier jour à la Passiflore ? Maëva était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit et une tentative d’explication était vaine, mais Benoît lui était en âge de ressentir la brutalité de la situation. Il était à l’école quand l’ASE avait téléphoné et ne devait rentrer que pour le déjeuner, j’envisageai de ne pas le mettre en classe dans l’après midi pour profiter encore un peu de lui avant son départ, mais mon esprit était perturbé et je ne parvenais pas à imaginer la meilleure façon de lui expliquer la situation.
Personne ne m’avait préparé à cela. Mon mari s’était isolé dans son studio d’enregistrement d’où s’échappaient les sanglots de sa guitare. Il n’avait pas commenté la décision de l’ASE, mais je sentais bien qu’il souffrait et que la colère grondait en lui.
Pour m’occuper l’esprit, j’entrepris de trier le linge des enfants pour le laver. Il y avait là les habits que Maëva portait le dimanche précédent, sa petite robe rose que j’avais choisie pour elle et dans laquelle elle était si jolie ; j’avais encore en mémoire le jour où nous l’avions acheté. Jade était avec moi et tenait la main de Maëva pendant que je fouillais les étals à la recherche de la robe dont je rêvais pour elle. Rien ne me plaisait vraiment, et soudain je l’avais aperçue cette petite robe rose, et en la voyant je sus qu’elle avait été faite pour Maëva. Le regard de Jade me confirma que c’était bien ce que nous cherchions.
La robe en main devant le lave-linge, je repensais avec nostalgie à cet instant de joie partagée, quand je vis qu’un petit bouton avait disparu. Je pensais qu’il faudrait en recoudre un autre avant que Maëva ne porte de nouveau sa robe, et cette pensée me replaça brusquement face à la cruauté de la situation : Maëva ne porterait plus cette robe ici à la Passiflore, parce qu’elle partait aujourd’hui même avec Benoît.
Depuis le coup de téléphone, quelque chose en moi s’était arrêté, le métronome qui rythmait cette vie heureuse s’était soudain enrayé et je perçus le manque de son tic tac rassurant à cet instant précis, parce que ce petit bouton disparu symbolisait à lui seul la disparition du bonheur. Je ressentis alors une douleur naître au plus profond de mon être et croître jusqu’à m’étouffer. Cela me fit si mal que j’éclatais en sanglots.
Je restais ainsi un long moment à pleurer le visage enfoui dans la robe rose, quand je sentis qu’on me tirait par la manche. C’était Maëva qui, sans doute alertée par mes pleurs s’était approché ; son petit visage était en larmes, nul doute qu’elle ignorait la cause de mon chagrin, mais parfois les enfants expriment ainsi leur compassion. Je tentais alors de faire bonne figure et je la serrais contre moi pour la consoler.
Benoît rentra pour le déjeuner, il était content parce qu’il avait appris une nouvelle comptine et il la récitait sans cesse. Il était si impatient de retrouver ses copains pour cette dernière journée de la semaine, que je n'eus pas le courage de lui expliquer la situation, ni de l’empêcher de retourner en classe. Je savais bien que je ne faisais que retarder une échéance inéluctable, mais il me fallait trouver des mots, et ils ne venaient pas.
Le soir nous nous lançâmes avec mon mari dans une longue explication pour dédramatiser la situation, mais cela sonnait faux et je ne sais pas ce que comprit réellement Benoît. Seules mes filles réalisèrent vraiment que les petits ne seraient plus là désormais. Elles avaient déjà vécu le départ de Geoffrey quelques mois auparavant, et elles savaient pertinemment tout ce que cela signifiait.
Nous retardâmes au maximum l’instant de conduire les enfants chez leur mère. Puis il fallut tout de même prendre la route. Pour eux cette partie du voyage était habituelle, car nous l’empruntions toutes les deux semaines lorsqu’ils allaient passer le week-end avec leur maman, mais pour moi ce fut un calvaire. Chaque minute nous rapprochait de l’instant de cette séparation que je redoutais par dessus tout.
Puis tout alla très vite, les retrouvailles habituelles avec la maman, les adieux sans trop montrer d’émotion pour ne pas inquiéter les petits. Puis le retour à la Passiflore.
La Passiflore, qu’en restait-il à présent ? La nouvelle famille que nous formions avait éclaté, et avec elle toute l’harmonie de notre vie. Rien ne serait plus jamais comme avant, j’en avais la certitude. Qui pouvait me certifier que la maison retrouverait un jour des rires d’enfants heureux, que le vieux piano jouerait encore juste, ou que la balançoire chanterait de nouveau au rythme des élans d’une fillette ?
Il me sembla brutalement entrer dans un long tunnel sombre et inquiétant dont je ne voyais pas l’issue. Que s’était-il donc passé ? Hier encore le soleil brillait et le bonheur se prélassait dans sa chaleur, soudain il fuyait inexorablement comme l’air s’échappe de l’enveloppe percée d’une baudruche, et le froid et les ténèbres s’installaient à sa place ; la laideur prenait le dessus sans que nous ne puissions l’empêcher.
Mais pourquoi faut-il que cela se termine toujours ainsi ? Pourquoi faut-il que la vie soit parfois si cruelle ?
VI
Les premiers moments sans Benoît et Maëva furent bien tristes. Mes filles étaient désemparées car elles s’étaient liées comme des sœurs à ces deux enfants, mais je fus bien en peine de fournir une explication logique à leur départ. Aujourd’hui la lumière est faite sur cette histoire, mais au moment des faits rien ne nous permettait de comprendre l’absurdité de la situation.
Bien sûr je me suis rebellée : c’est dans ma nature profonde de tenter de comprendre ce qui me touche. J’ai questionné l’ASE, mais je n’ai reçu qu’une simple réponse laconique : désormais le sort des enfants ne me regardait plus !
On me fit également comprendre que, pour leur bien, il était préférable de ne pas poser de questions.
C’était ainsi dans les services sociaux, du moins dans ceux qui eurent en charge Benoît et Maëva. Les enfants et les familles d’accueil ne représentaient que la matière première de leur ouvrage, et la matière première ne doit pas exprimer ses états d’âme, ni comprendre les tenants et aboutissants d’une œuvre qui la dépasse.
Nous n’étions que les rouages d’une vaste mécanique, qui une fois lancée, ne pouvait être arrêtée ou déroutée. A-t-on déjà entendu la matière première se plaindre de son sort ? La farine s’inquiète-t-elle de ce que le boulanger la pétrisse et la cuise pour en faire du bon pain ? Le verre en fusion se préoccupe-t-il du sort qui lui sera échu alors que le souffleur le transforme en élégantes boules de Noël ? Non, cette matière première ne se plaint pas, parce qu’elle sait qu’elle est entre les bonnes mains d’artisans amoureux de leur métiers, et qui mettent tout leur cœur à l’accomplissement de leur ouvrage. Mais Benoît et Maëva n’était pas une pâte malléable, et l’avenir a montré qu’ils ne furent pas confiés aux bonnes mains d’artisans vertueux, mais à des mains sales et cupides.
En l’absence de réponse officielle, nous avons échafaudé mille hypothèses : nous reprochait-on quelque chose ? Notre attachement aux enfants avait-il été mal interprété ? Je me souvins des confidences que m’avait faites cette assistante maternelle rencontrée en Avignon, elle m’avait mise en garde à ce sujet et affirmé que les services sociaux n’appréciaient guère la complicité et l’amour portés aux enfants confiés.
Peut-être l’assistant social référent qui nous visitait, avait-il entendu trop souvent Benoît m’appeler “maman”, et avait-il jugé notre relation avec les enfants trop affectueuse ? Leur mère était-elle à l’origine de ce transfert ? A cette question, la maman des enfants nous affirma qu’elle n’y était pour rien, et qu’elle-même avait été mise devant le fait accompli. Cette femme avait volontairement placé ses enfants à l’ASE, et il semblait logique qu’elle fut consultée pour tout changement important de leur condition de vie, mais il n’en fut rien. Par bonheur nous avions sympathisé avec elle, ce qui nous permit d’avoir des nouvelles par son intermédiaire, et aussi plus tard un contact furtif avec les enfants.
Cette période troublée me perturba énormément, j’en perdis le sommeil et durant mes longues heures d’insomnie, je ne pouvais m’empêcher de penser aux petits.
A force de persévérance je réussis à obtenir une entrevue avec Madame D., chef de l’Unité Territoriale du Comtat et Madame R., Médecin Promotion de la Santé. Nous fûmes reçus, mon mari et moi, mais nous n’apprîmes rien de plus sur le transfert des enfants : on nous déclara simplement « qu'il n'y avait rien à comprendre ». En revanche, on nous donna quelques informations sur leur nouvelle famille d’accueil. Le couple avait déjà deux enfants en bas âge et la femme en attendait un troisième.
Voilà tout ce que l’on voulut bien nous apprendre. Ces révélations éclairèrent d’avantage l’absurdité de la situation ; ainsi Benoît et Maëva avait été retirés d’un cadre de vie idéal pour être placés, contre l’avis de tous ceux qui s’intéressaient à eux, dans une famille déjà composée de trois petits enfants dont un nouveau-né, aux bons soins d’une jeune femme qui devrait dorénavant s’occuper à elle seule de cinq enfants. Dans mon foyer j’étais disponible à plein temps pour les enfants, et mes filles me secondaient avec efficacité. Il y avait dans tout ceci une logique qui m’échappait.
Puis vint le temps de la résignation. Nous avions fait de notre mieux pour ces enfants, mais notre rôle s’arrêtait là. Certes, l’amour et la chaleur régnaient dans notre foyer, mais nous n’en avions pas le monopole, et il n’était pas exclu que Benoît et Maëva ne retrouvent pas un équilibre semblable dans leur nouvelle vie. C’était ce que nous espérions tous, qu’ils trouvent de l’affection et qu’ils puissent s’épanouir, comme ils avaient pu le faire chez nous.
VII
Les semaines puis les mois passèrent. Je prenais régulièrement des nouvelles des enfants auprès de leur maman qui les recevait tous les quinze jours. Je les revis parfois chez elle, et il arriva même que je les emmène chez moi, mais c’était illégal sans l’accord de la famille d’accueil. Le risque était grand, s'il était arrivé quelque chose aux enfants, alors qu’ils étaient censés être sous la garde de leur mère, nous aurions tous eu de gros problèmes. La rupture fut donc inévitable.
Il s’écoula des jours, puis des semaines, qui formèrent bientôt quatre longs mois durant lesquels mon désir d’accueillir de nouveaux enfants s’atténua un peu. Ma confiance en l’ASE avait pris un sérieux coup, et je n’étais plus certaine de vouloir renouveler l’expérience. Mon esprit restait perturbé par le souvenir douloureux du départ des petits, et mon indignation, quant à la manière dont il s’était déroulé, faisait maintenant place à du dépit.
J’avais occasionnellement des nouvelles de Benoît et de sa petite sœur par leur mère au téléphone, mais j’avais totalement perdu l’espoir de les revoir dans de bonnes conditions, autrement qu’à la sauvette, ce qui n’aurait été bon ni pour les enfants ni pour moi.
Les responsables de l’ASE avaient-ils compris mon désarroi ? J’en doutais, mais ils ne me proposèrent pas de nouveaux enfants et finalement ce fût mieux ainsi. Après m’être tant investie avec Benoît et Maëva, j’avais besoin de temps pour que mon cœur retrouve l’apaisement et qu’il soit de nouveau disponible. Je n’avais jamais envisagé accueillir des enfants avec indifférence, ma nature sentimentale me l’aurait interdit, pour moi l’accueil ne pouvait se faire qu’à cœur ouvert. J’étais mère et l’amour des enfants m’était primordial. L’attitude de certains professionnels du social qui gardent une distance avec les personnes dont ils ont la charge, m’est totalement incompréhensible.
Mais c’était peut-être moi qui était dans l’erreur, peut-être que l’ASE avait raison ; ces “super” professionnels savaient sûrement ce qu’ils faisaient en déplaçant à leur gré des enfants, en les arrachant à des familles d’accueil aimantes, en les soustrayant à une vie douce et agréable ; et ce n’était sûrement pas moi, petite assistante maternelle ignorante du grand plan des dieux de l’aide sociale, qui allait leur apprendre leur métier.
Certes, mais ni mon cœur, ni mon âme, ni mon esprit, ne pouvaient l’admettre.
"Le doute n'a rendu fou personne, alors que la certitude de détenir la vérité a provoqué les plus graves folies de l'humanité". Frédéric Nietzsche
VIII
“Maëva perd ses cheveux”, m’affirma sa mère au téléphone. “Vous savez ce n’est pas nouveau”, reprit-elle, “il y a déjà quelques temps que ma fille semble triste, et elle pleure maintenant à chaque fois que je la reconduis dans sa famille d’accueil. Cela ne lui arrivait jamais quand elle vivait chez vous, mais depuis qu’elle n’y est plus, elle a perdu sa joie de vivre. Je suis vraiment inquiète, et maintenant je m’aperçois qu’elle perd ses cheveux. Et il y a autre chose de plus inquiétant, j’ai remarqué des bleus à son oreille et des bosses sur son front.”
Elle me raconta que régulièrement la famille d’accueil ne lui emmenait pas ses enfants comme il était convenu, et que devant ses interrogations, le couple avait toujours une bonne raison à opposer : voiture en panne, ou enfants malades.
Elle m’apprit aussi qu’il ne fut pas permis à Benoît de prendre son vélo avec lui, le couple prétexta un risque de jalousie entre les enfants pour l’interdire. Chez sa mère qui vivait en ville dans un immeuble, il n’y avait pas d’espace sécurisé, et Benoît n'eut quasiment plus l’opportunité de faire du vélo. Ce fut un sacrifice pour lui qui aimait tant ce vélo que sa maman lui avait offert et qui symbolisait l’affection qu’elle lui portait.
Sa voix se brisa dans un sanglot. Cette maman n’était pas une mère indigne, le fait qu’elle ait placé ses enfants ne lui enlevait en rien le mérite de l’amour qu’elle avait pour eux, même s’il se manifestait de façon singulière.
Je lui conseillais de déclarer ses craintes à l’ASE qui ferait ce qu’il faudrait, mais elle m’affirma qu’elle avait déjà entrepris ces démarches et que l’administration ne semblait pas l’entendre ; il lui fut répondu que sa fille perdait ses cheveux à cause d’un état dépressif.
La maman me pria d’intervenir à mon tour pensant sans doute que ma qualité d’assistante maternelle donnerait plus de poids à sa requête. Je fis ce qu’elle m’avait demandé, je le fis surtout pour Maëva, dont le revers du sort qu’elle subissait m’inquiétait au plus haut point. Hélas, je ne pesais pas bien lourd, et personne ne daigna m’écouter moi non plus.
Je fus indignée de l’indifférence qu’on nous manifesta : comment ces professionnels pouvaient-ils rester insensibles aux inquiétudes d’une mère et d’une assistante maternelle ? Cette condescendance à mon égard m’agaçait, mais la cause principale de mon indignation était le mépris de nos soupçons de maltraitance sur Maëva.
Les services sociaux étaient sourds et aveugles, mais pas muets, et on me fit savoir sèchement que le sort de Benoît et Maëva ne me concernait plus puisqu’ils ne vivaient plus chez moi. Cette phrase je l’entendrai ensuite à l’excès, jusqu’à la nausée, mais loin de me décourager, elle renforça ma conviction qu’il fallait que j’aille jusqu’au bout pour aider ces enfants.
IX
La situation des enfants devenait inquiétante. Maëva semblait la plus affectée, la perte de ses cheveux, les traces et les bleus sur son visage, son mutisme et la tristesse de son regard, tout ceci aurait dû alerter les professionnels chargés de son bien-être.
Il y eût bien un médecin diligenté auprès de la fillette, pour tenter de comprendre ce qui se passait, mais ce médecin de promotion de la santé, Madame R., ne constata rien d’anormal. C’est sans doute elle qui expliqua la chute des cheveux de Maëva par un état dépressif, cette explication devint d’ailleurs la version officielle retenue par l’ASE.
Cet état dépressif s’il était avéré, aurait dû déclencher des investigations approfondies : quelques mois auparavant Maëva était pétillante de vitalité et de joie de vivre, que s’était-il passé depuis, pour qu’elle sombra dans la dépression au point d’en perdre ses cheveux ? Et que dire des traces suspectes sur son visage ? Benoît était moins marqué, parce qu'il était sans doute plus docile, et qu'il se soumettait. Pauvre Benoît, si sensible et débordant d'affection, alors qu’il aurait dû s'épanouir, à l'aube de ses cinq ans, alors que la joie et l'insouciance aurait dû le porter, c'était le désespoir qui pénétrait sa petite âme d’enfant en ces années de misère.
Pour la mère des enfants, comme pour moi-même et mon mari, il ne faisait aucun doute que Maëva subissait des sévices, et nos soupçons se portèrent sur la famille d’accueil. Mais faute de preuves et en l’absence de toute aide de l’administration, nous étions bien en peine de faire valoir notre point de vue.
X
La chatte regardait le petit garçon, qui lui-même regardait ses chatons. Elle avait mis bas quelques semaines auparavant dans cette curieuse famille où les enfants allaient et venaient, un peu comme elle le faisait elle-même, mais ce comportement normal pour un félin, était étrange pour des enfants.
Ces deux petits humains, garçon et fille, passaient le plus clair de leur temps ailleurs, puis parfois résidaient ici et formaient avec leur propre mère une famille provisoire. La chatte ignorait où était cet ailleurs.
Elle aussi formait une famille avec ses petits, un mâle et une femelle, mais ce qui étonnait vraiment la chatte, c’était la différence d’évolution qu’elle constatait jour après jour, entre ses chatons et les enfants : alors que les petits félins s’ouvraient à la vie, jouaient et s’émerveillaient de la découverte du monde, les enfants s’assombrissaient, se refermaient, pleuraient souvent, et se rebellaient aussi.
Quelques jours plus tôt, le petit garçon avait voulu mettre le feu à l’appartement et s’il n’y avait eu une réaction rapide de la mère, tout aurait flambé. Depuis, la chatte surveillait le garçon d’un œil méfiant, surtout lorsqu’il s’approchait de ses chatons.
Le garçon regardait les chatons, il savait qu’il y avait un chaton garçon et un chaton fille, des petits, tout comme lui et sa petite sœur Maëva. Les chatons jouaient avec une balle de laine, leurs petites griffes se prenaient dans la fibre et pour s’en défaire, ils faisaient de grands mouvements de pattes, mordillaient, miaulaient, sautillaient, se chamaillaient, en un mot ils vivaient, et tout à coup le petit garçon eut envie d’être un chaton, parce qu’il lui sembla que leur vie était bien plus heureuse que la sienne. Il aurait voulu être un chaton pour jouer avec sa sœur-chaton et une balle de laine, sautiller et mordiller et rire : rire à en perdre haleine, rire comme ils le faisaient quand ils vivaient à la Passiflore.
Tout à coup il fut saisi d’un élan fraternel pour les félins, et il les prit dans ses bras. Les chatons se laissèrent faire et l’enfant les caressa avec sa joue. La chatte se redressa, les oreilles droites et les yeux écarquillés, elle fixait l’enfant avec l’inquiétude d’une mère qui pressent le danger. Soudain l’enfant lui tourna le dos, et elle perdit de vue ses petits, puis un claquement sec aux accents métalliques la fit sursauter.
Lorsque l’enfant se retourna, elle lut une grande tristesse dans ses yeux. Elle chercha du regard ses petits, mais ils avaient disparu.
XI
“Je suis complètement dépassée par le comportement de Benoît, me dit sa mère au téléphone, il fait bêtise sur bêtise, je ne sais plus comment m’y prendre avec lui et pourtant je n’ai les enfants qu’un week-end sur deux. Savez-vous qu’il a failli mettre le feu à l’appartement ? Et ce matin, il a jeté mes deux petits chatons dans la poubelle murale, vous vous rendez compte ? Heureusement que nous sommes au premier étage, les chats n’ont pas été blessés, c’est une chance, mais comment expliquer ce comportement ?”
Sans doute, pensais-je, a-t-il reproduit sur les chatons ce qu’il subit lui-même dans sa vie ; Benoît et Maëva se sentaient abandonnés, tout comme les chatons ont été abandonnés dans la poubelle. Cette idée m’était venue en écoutant le récit de la maman, mais l’hypothèse n’était pas saugrenue.
Il y eut un silence, puis je m’inquiétais de la santé de Maëva. Sa mère m’expliqua que sa situation avait empirée : désormais Maëva ne parlait plus, semblait s’être refermée sur elle-même et la perte de ses cheveux était de plus en plus évidente. La maman insista pour que nous tentions une nouvelle entrevue avec l’ASE, et je lui donnais mon accord sans me faire prier, car l’inquiétude de cette femme, s’ajoutant à la mienne, me plongeait dans l’angoisse.
L’ASE nous reçut, mais le scénario précédent se reproduisit : on me tapa de nouveau sur les doigts en me faisant comprendre que je devais cesser de m’immiscer dans la vie de Benoît et Maëva. Malgré tout, devant notre insistance on nous promit que l’assistante maternelle en garde des enfants serait interrogée, et nous apprîmes par la suite qu’elle attribua la perte des cheveux de la fillette à de l’automutilation. Cette nouvelle version des faits devint aussitôt la nouvelle version officielle de l’ASE.
Dès lors, je compris que les services sociaux ne nous aideraient pas, et il nous fallut trouver d’autres alliances. C’est ainsi que j'eus l’idée de me rapprocher de la pédiatre qui avait suivi ma plus jeune fille autrefois.
Ce médecin de Carpentras accepta aussitôt de nous recevoir et nous profitâmes d’un week-end où la maman avait la garde de ses enfants pour la rencontrer. Sur son bureau trônait la photo de Jean-Loup Chrétien, le premier spationaute français à avoir effectué un vol dans l’espace ; j’appris par la suite qu’il était de sa famille.
La pédiatre était gentille et attentive à nos remarques. Elle établit rapidement une relation de confiance, puis ausculta Maëva et constata qu’elle semblait effectivement maltraitée.
Je l’interrogeais sur l'automutilation, elle me répondit qu'à l’âge de Maëva, ce trouble du comportement n'existait pas.
Nous l’avons rencontrée deux fois, et à chacune de nos visites elle ouvrit spécialement son cabinet le samedi après-midi pour nous recevoir gratuitement ; la seconde fois elle constata de nouvelles traces de maltraitance. Nos soupçons étaient donc malheureusement confirmés.
Plus tard, une amie s’étonna de ce que la pédiatre ne signala pas elle-même la maltraitance. Sans doute ce médecin de l’enfance pensa que nous finirions, la maman et moi-même, par être entendues, la maltraitance étant si évidente.
J’ai gardé tous les courriers qui ont jalonné mon long combat pour aider Benoît et Maëva. Parmi ces lettres, j’ai retrouvé celle que m’envoya la pédiatre à la suite d’un présent que je lui avais fait pour la remercier de son aide.
Décembre 1994
Docteur H. M. C.,
«...vous remercie de votre attention qui m'est allée droit au cœur, comme cette enfant pour laquelle vous vous battez, et Dieu sait que je suis à vos côtés. Tenez-moi au courant de vos péripéties administratives. Milles pensées amicales pour vos filles et la petite Maëva... »
Quelques mois plus tard, elle fit à ma demande une attestation écrite de son constat des signes de maltraitance. Ce document était destiné au Médecin Chef de la Commission Consultative Paritaire Départementale devant laquelle je dus comparaître.
Je remercie cette femme pour l'écoute et le soutien qu'elle nous a apporté. Elle fut la première professionnelle de l'enfance à s’honorer de l’avoir fait, et à ce titre, elle est digne d'être citée en exemple dans ce témoignage. Puisse-t-elle un jour lire ces lignes.
XII
“Je vous ai convoqué aujourd’hui pour faire le point sur votre agrément et votre employabilité en qualité de famille d’accueil.”
La femme qui venait de parler était Madame G., Présidente par délégation, attachée territoriale des services de l'ASE, et nous étions, mon mari et moi, dans son bureau de la Direction de la Vie Sociale, au service de l'Unité Territoriale du Comtat. Le médecin de promotion de la santé, Madame R., qui avait ausculté Maëva sans rien voir d’anormal était aussi présente.
J’échangeais un regard las avec mon mari. Ainsi le sujet du jour ne concernait pas la situation des enfants, mais notre aptitude à demeurer une famille d’accueil, sans aucun doute mon opiniâtreté pour tenter de faire réagir les services sociaux avait exaspéré l’ASE.
Je me doutais bien que mes démarches répétées me créeraient des ennuis avec l’administration, et semblait-il le jour était venu de payer mes crimes de lèse majesté.
Sentant bien que la situation m’échapperait si je laissais le débat tourner autour de mes écarts de conduite, j’attaquais bille en tête en présentant mes soupçons de maltraitance sur les enfants. Mais les deux femmes n’avaient pas l’intention de s’en laisser conter, et elles nièrent la possibilité de la maltraitance en nous expliquant que les symptômes observés sur Maëva étaient dus à un conflit entre le frère et la sœur, laissant entendre que Benoît frappait Maëva.
Cette nouvelle version nous surprit : les chamailleries entre frère et sœur sont normales, mais pas au point de se faire du mal. Nous tentâmes d’expliquer à ces professionnelles de l'enfance que, chez nous, les petits ne se frappaient jamais. D'ailleurs, au fond de moi j'avais plutôt gardé la vision de Maëva prenant l’ascendant sur son grand frère qui ne se défendait pas, et non le contraire.
J’avais toujours en mémoire mon petit Benoît en pleurs à l'école lorsque le « grand Thomas » lui avait fait des misères. Ce grand Thomas qui était dans la seconde section de maternelle l’effrayait car il le bousculait souvent, profitant de son caractère craintif et sensible. En d’autres circonstances, ce souvenir aurait pu me faire sourire, mais cette fois-ci il raviva ma tristesse et j’en eus le cœur encore plus gros.
Comment les services sociaux pouvaient-ils laisser entendre que Benoît frappait sa sœur, lui qui était incapable de toute violence ?
Je démontrais de la façon la plus simple que les enfants n'avaient pas de difficultés entre eux lorsqu'ils vivaient chez nous et qu’il n’y avait aucune raison pour que ce soit le cas à présent, et puis surtout, je mis en évidence les nombreuses contradictions entres les différentes versions avancées pour expliquer les symptômes observés sur Maëva : d’abord la dépression, puis l’automutilation, et maintenant un conflit entre frère et sœur, où était la vérité dans tout cela ?
Mais les femmes s'obstinèrent, elles n’avaient cure de mes remarques. Le sort des enfants leur était complètement indifférent : ce qui leur importait, c’était que j'empiétais sur les plates-bandes des services sociaux, et elles voulaient uniquement sanctionner mon attitude.
Elles m’avertirent que j’étais sur la sellette et que mon comportement n’était pas digne d’une professionnelle. Elles insistèrent sur le fait que j’outrepassais mon rôle en m’immisçant dans les dossiers de l’ASE, et que je refusais de comprendre ce que l’on m’avait déjà répété maintes fois : les enfants n’étant plus chez moi, leur sort ne me concernait plus. La conclusion tomba brutale, « Si vous persistez dans vos démarches de signalement auprès de nos services, nous vous enlèverons votre agrément, point final !».
Ces menaces ne m’impressionnèrent pas, de toute façon, on ne m'avait plus confié d'enfant depuis le départ des petits, j’avais déjà compris le message.
Seulement, ce qu'elles ignoraient c'est que j’aimais ces enfants, et rien ni personne ne m’empêcherait de faire mon possible pour les aider.
Jusqu’alors je pensais que les services de l'ASE étaient les bons interlocuteurs, mais ce jour là je me rendis compte que, non seulement ils faisaient la sourde oreille, mais qu’en plus c’étaient eux qui avaient choisi le guêpier dans lequel ils avaient fourré les enfants.
XIII
La situation de Maëva ne s’améliorait pas. J’avais espéré qu’après toutes les démarches entreprises pour mettre en lumière leurs actes de maltraitance, la famille d’accueil aurait au moins eu l’intelligence de se tenir un peu tranquille. Mais il n’en fut rien. Le calvaire de Maëva continua. Elle ne parlait plus du tout et son petit corps était toujours aussi martyrisé. Elle sombrait lentement dans l'autisme.
Les recours auprès de l’ASE m’étant désormais interdits et de toutes façons inutiles, je décidais d’en parler à l’adjudant P, le commandant de la gendarmerie de mon village, Beaumes-de-Venise. C’était un homme charmant que je connaissais un peu et dont j’appréciais les qualités humaines.
Le gendarme m’écouta attentivement et prit en considération toutes mes remarques et mes soupçons. Il proposa de prendre lui-même contact avec les services sociaux pour tenter d’éclairer la situation.
Malheureusement les services de l’ASE le dirigèrent vers la personne en charge du dossier, la présidente-chef de l'Unité territoriale, Madame D.
Tout semblait tourner autour de cette femme ; c’est elle qui délivrait les agréments, choisissait les familles d’accueil et dirigeait les enfants d’un foyer à l’autre. Elle était le pivot de cette machination dont Benoît, Maëva, mais aussi de nombreux autres enfants, firent les frais. Mais ce dénouement nous ne l’apprîmes que bien plus tard. A ce moment de l’histoire Madame D. avait encore tout pouvoir.
L’adjudant P. fut décontenancé par la réponse laconique de Madame D. “J’ai reçu une douche froide”, me dit-il. Selon Madame D, Maëva était une comédienne et il n’y avait aucun problème, elle précisa aussi que la fillette était suivie par un assistant social garant de son bien-être.
Plus tard l’adjudant P. me fit une lettre pour expliquer sa démarche : cette lettre me fut utile lors de mon passage en commission.
Voici les termes de ce courrier :
12 juin 1995
L’adjudant P. commandant de la Brigade…
Objet : placement de Maëva âgée de 4 ans par la DVS.
A votre demande, je vous précise que j’ai bien contacté téléphoniquement Madame D, Présidente de l’Unité Territoriale à Vaison-la-Romaine, au mois de décembre 1994 afin de lui faire part des inquiétudes concernant l’état de santé de la petite Maëva âgée de 3 ans et demi à l’époque, qui se trouvait placée dans une famille d’accueil à Pernes-les-Fontaines.
Les renseignements que vous aviez recueillis laissaient présager que cette enfant faisait une dépression et que les parents d’accueil créaient des difficultés pour que la maman légitime rencontre son enfant aux jours et aux heures de visite.
Madame D m’avait alors informé que Maëva avait été placée par décision de la DVS et m’avait rassuré en m’indiquant que cette petite fille était « comédienne » et qu’elle était suivie par un travailleur social de Pernes.
Je vous signale par ailleurs que cette démarche n’avait été faite que pour faciliter vos rapports avec Madame D, qui est une professionnelle de l’enfance et afin de lui rapporter des faits dont vous aviez eu connaissance.
Je vous autorise par ailleurs à faire état de notre entrevue et que les responsables territoriaux de la DVS peuvent s’ils le désirent contacter mes services pour des renseignements complémentaires…
XIV
La réaction de l’ASE ne se fit pas attendre. Quelques jours après avoir répondu à l’adjudant P., Madame D. m’informa par courrier que la commission paritaire départementale allait procéder à la révision de notre agrément de famille d’accueil.
Ainsi l’ASE mettait ses menaces à exécution, mais loin de m’intimider cela décupla ma volonté. Je compris que désormais le combat devait prendre une autre dimension et qu’il fallait aller plus haut.
J’entrepris alors une série de démarches auprès de personnalités politiques.
Au cours de ma formation, j'avais entendu parler du Maire de Sorgues, monsieur M. qui devint Sénateur en 2004. A l'époque, il était Président de la Commission Vie Sociale. On m’avait dit que ce médecin faisait preuve d’humanité et était à l'écoute des citoyens. Je rencontrais le maire de mon village qui prit note des faits, et qui envoya un courrier à cet homme politique.
Le Maire de Sorgues agit en conséquence, mais son enquête s’arrêta à la porte du bureau de Madame G. qui tenait elle-même ses informations de Madame D. Celle-ci évidement répétait à qui voulait bien l’entendre, qu’il n’y avait pas de problème et elle ajouta pour me discréditer, que mon agrément était en cours de révision.
Les arguments de Madame D. ayant plus de poids que les miens, la piste du maire de Sorgues s’arrêta ici. Mais personne ne prit l’initiative d’aller voir directement le problème à la base, personne ne rencontra les enfants ni leur mère, pas plus qu’ils ne s’intéressèrent à la famille d’accueil.
Je ne baissais pas les bras pour autant et j’écrivis une longue lettre au Ministère des Affaires Sociales à l'attention de Madame Simone Veil, dont voici la réponse :
Le 6 avril 1995
« Madame Simone Veil, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, a pris connaissance de la correspondance... J'ai l'honneur de vous faire savoir que, bien que Madame le Ministre d'Etat comprenne que cette situation soit vécue douloureusement par chacun, il ne lui est pas possible d'intervenir car il s'agit là d'une affaire qui ne relève pas de sa compétence. En effet, depuis 1983 la loi sur la décentralisation a confié au Président du Conseil Général l'ensemble des missions de l'aide sociale à l'enfance qui était auparavant exercées par l'Etat. Toutefois, soyez assurée que cette situation fait l'objet d'une attention particulière des services concernés... »
La secrétaire de Madame Veil me contacta par la suite, m'exprimant sa sympathie tout en me proposant de la rappeler s'il y avait une évolution dans cette affaire. C'était agréable d'être entendue, même si je savais que cet appui était lointain et sans nul doute dérisoire. Malheureusement cette démarche n’apporta rien de plus pour soulager les souffrances de Maëva et de Benoît.
XV
Lors de mon entretien avec l’adjudant P., celui-ci avait évoqué la présence de l’assistant social auprès de Maëva, je décidais de le contacter, espérant ainsi avoir des informations sur le sort de la petite.
Lorsque les enfants vivaient chez nous, nous avions un très bon contact avec ce professionnel, au point qu’il nous avait donné ses coordonnées. Je fis plusieurs tentatives pour lui parler au téléphone, directement à son bureau puis chez lui, mais je ne parvins pas à le joindre et il ne me rappela jamais.
En désespoir de cause nous décidâmes, mon mari et moi de nous rendre à son domicile. Il ne pouvait pas refuser de nous parler, nous étions presque amis, je l’avais même déjà vu en compagnie de ses propres enfants, c’était un père de famille respectable et il me semblait évident qu’il comprendrait mon inquiétude.
Nous nous présentâmes donc à son domicile, mais ce jour là malheureusement il ne semblait pas être chez lui. Nous n’insistâmes pas et nous reprîmes la route du retour, assez déçus.
Quelques jours plus tard je reçus une lettre de semonce, de la part du Directeur de la Vie Sociale :
Le 18 mai 1995
“J'ai été informé par monsieur F, Assistant Social Enfance, référent des enfants Benoît et Maëva, de votre intervention à son domicile le 27 mars dernier. Ce fait constitue une atteinte intolérable à la vie privée de ce professionnel qui motiverait (en cas de reproduction) un dépôt de plainte à votre encontre. Par ailleurs, votre démarche témoigne que vous continuez à vous immiscer dans le suivi par mes services des enfants qui ne vous sont plus confiés, malgré les recommandations faites par madame G, inspecteur de l'ASE. Par conséquent, je vous enjoins de cesser toute intervention de ce type faute de quoi je serais amené à prendre les mesures qui s'imposent ».
XVI
Ces mesures finirent par tomber, et je fus convoquée en Avignon face à la Commission Consultative Paritaire Départementale qui devait statuer sur le sort de mon agrément.
Toutes ces personnalités postées aux divers échelons de l’ASE que j’avais tenté d’alerter sur le sort des enfants, me faisaient penser à un troupeau de moutons. La Passiflore avait eu son mouton autrefois. Cet animal était incapable de la moindre initiative ; il suivait le chien lorsqu’il allait se promener, et immanquablement le chien revenait seul après avoir semé le gêneur, qui bien sûr ne retrouvait jamais son chemin. Les acteurs de l’ASE se comportaient de même, incapables de la moindre initiative, l’un suivant l’autre, et ils se sont perdus. Il aurait suffit que l’un d’eux se pose cette simple question : « Suis-je sur la bonne route dans cette affaire ?» pour qu’enfin la version officielle soit battue en brèche et qu’éclate la vérité sur le sort des enfants. Mais les moutons ne sont pas dotés d’esprit d’initiative semble-t-il.
Pendant ce temps là les sévices sur les enfants continuaient, continuaient, continuaient…
Le 14 juin 1995 je passais devant la Commission Consultative Paritaire Départementale.
Je suis de nature timide et, d’ordinaire je ne prends pas facilement la parole dans une assemblée, mais ce jour-là c’est une femme déterminée et motivée que durent affronter les trois membres de la commission.
Je m’étais bien préparée à cette entrevue. Forte de mon expérience de la réunion précédente, je savais pertinemment que l’issue serait la déchéance de mon agrément, mais je m’en fichais bien, tout ce que je voulais, c’était jouer ma dernière carte pour défendre les enfants.
Les membres de la commission étaient tous les supérieurs hiérarchiques des personnes auxquelles j’avais eu affaire jusqu’à présent. Si j’étais entendue par cette commission, il y aurait un espoir pour que cesse la maltraitance sur les enfants.
J’avais avec moi divers documents attestant des signes de maltraitance, et aussi de la bonne santé des enfants lorsqu’ils vivaient chez moi. Tout ceci mettait en perspective la différence de comportement de Benoît et Maëva, avant et après leur arrivée dans la nouvelle famille d’accueil. Je voulais ainsi prouver qu’ils étaient aujourd’hui malheureux et probablement maltraités.
Je transmis au Médecin le courrier que m'avait remis la pédiatre, puis au Président la lettre du commandant de gendarmerie. J'avais aussi une pétition, soutien de mon entourage, pour démontrer combien les enfants étaient heureux et épanouis chez nous. Il y avait, avec tous ces mots chaleureux, quelques signatures d'amis et de voisins, celle des maires de mon petit village et du village voisin où Benoît était scolarisé. Parmi ces mots de soutien, il y avait aussi ceux de la maîtresse de Benoît, celle qui pour lui me nommait « maman » à la sortie des classes. Cette institutrice décrivit l’évolution positive de Benoît durant l’année scolaire lorsqu’il vivait chez moi.
Avec le recul, je sais que la pétition fut complètement inutile, comme tout le reste d’ailleurs, mais dans ce cas là, alors qu’il s'agissait de défendre des enfants, c’est la spontanéité de chacun qui s’exprima.
Les trois membres de la commission me firent simplement la politesse de me laisser parler. Le Président du Conseil Général semblait s’intéresser à mon histoire et m’écoutait attentivement tout en me posant quelques questions. Mais avait-il le moindre poids face aux hautes instances de l’ASE ? Je compris vite que tout était vain. Le seul but de cette réunion était de faire la démonstration de mon implication trop active dans le suivi des enfants.
Cependant, je développais jusqu'au bout mes arguments sur mes soupçons de maltraitance ; je voyais bien que je laissais tout le monde indifférent, mais je persistais au risque de provoquer l’exaspération. Je voulais simplement qu’ils comprennent l'état dans lequel se trouvait Maëva, qu’ils sachent que personne ne m'avait écoutée, et que l’ASE était responsable de cet état de fait.
Quelques jours plus tard, je reçus la lettre qui m’annonçait le retrait de mon agrément. Rien cependant dans ce courrier ne laissait entrevoir que mes soupçons de maltraitance aient été pris en considération.
C'est Madame D, la chef de l’Unité Territoriale du Comtat qui m'avait donné l'attestation d'agrément, c'est elle qui me l’enleva.
Leur agrément, je leur laissais volontiers, ils pouvaient bien aller au diable.
« A chacun de nous, Dieu offre le choix entre la vérité ou la tranquillité. Ce choix, faites-le ; jamais vous n'obtiendrez à la fois l'une et l'autre ». Ralf Waldo Emerson
Sous l’aile des services sociaux.
XVII
La fillette ne dormait pas. Pelotonnée dans son lit, son pouce dans la bouche, les yeux ouverts, elle guettait le moindre bruit de cette nouvelle chambre où on l’avait mise.
Un enfant qu’elle ne connaissait pas grogna dans son sommeil, et la fillette pensa à son frère Benoît, qui était resté là-bas, chez la méchante femme. On lui avait permis d’emporter son doudou, alors elle le serra plus fort. Pourquoi Benoît n’était-il pas ici avec elle ? Ils n’avaient jamais été séparés, et aujourd’hui Maëva faisait la première expérience de la solitude, et cette expérience était cruelle. Son grand frère, son soutien de toujours, lui manquait terriblement, il lui semblait que la seule flamme qui réchauffait sa misérable vie avait été soufflée, et elle ressentait le froid jusqu’au plus profond de son âme. Elle ressentait ce manque comme un abandon, comme un saut dans l’inconnu. Certes, elle avait vécu dans le calme cette première soirée au foyer, et cela était nouveau depuis longtemps, depuis les jours heureux à la Passiflore, mais ces jours lui semblaient si loin que le goût du bonheur avait depuis longtemps perdu sa saveur.
A la solitude et au calme de ce lieu, s’opposaient la présence de son frère et les brimades de la méchante femme. A tout prendre, elle se demandait ce qui lui pesait le moins, être au calme mais sans son frère, ou être avec lui mais subir les coups de la méchante femme.
D’ailleurs avait-elle jamais connu autre chose que les brimades, les cris et les coups ? Elle n’avait plus la réponse à cette question, désormais s’imposait dans son esprit, l’idée que la vie était ainsi, cruelle et insupportable, et que les grandes personnes étaient toutes méchantes.
C’est pour cela qu’elle n’avait pas répondu aux questions de la maîtresse qui s’inquiétait des marques sur son visage ; elle avait aussi refusé de parler aux gendarmes qui l’avait questionnée parce qu’ils l’effrayaient, et elle n’avait pas non plus parlé à l’assistant social, qui était arrivé d’urgence sur sa moto, et qui l’avait ensuite conduite dans ce lieu où vivaient déjà de nombreux enfants. C’est dans la voiture qu’elle avait pleuré, parce que c’était à ce moment qu’elle avait ressenti le plus intensément l’absence de son grand frère.
La fillette était là dans ce lit qu’elle ne connaissait pas, parmi d’autres enfants qu’elle ne connaissait pas, loin de son frère qui lui manquait, et c’est ainsi qu’était sa vie désormais. Alors privée de son seul soutien, elle ferma son esprit pour combattre la frayeur qui l’assaillait. Elle tissa autour d’elle une enveloppe de silence et de mutisme que personne ne pourrait rompre. Ils pouvaient bien la maltraiter, la frapper, crier sur elle, plus jamais ils ne l’atteindraient, enfermée qu’elle était dans cette bulle protectrice, ultime refuge de son âme.
XVIII
“Ils ont retiré Maëva de sa famille d’accueil”, me dit sa mère surexcitée, en arrivant chez moi de bon matin. Elle m’expliqua que les institutrices de l’école qui accueillaient sa fille, excédées devant les absences non justifiées et les traces de coups sur le visage de la fillette, avaient prévenu les gendarmes du village qui avaient aussitôt lancé une procédure pour protéger Maëva. L’ASE avait délégué d’urgence l’assistant social référent qui avait conduit la fillette dans un foyer ; Benoît quant à lui fut laissé dans la famille d’accueil.
Ce furent les gendarmes de la commune de Pernes-les-Fontaines où vivait cette famille qui intervinrent.
Nous les avions rencontrés quelques temps auparavant, la mère des enfants, leur grand-mère et moi-même pour leur faire part de notre inquiétude. Lors de cette entrevue, les gendarmes nous avouèrent leurs soupçons sur cette famille, mais ils nous expliquèrent qu’ils ne pouvaient intervenir faute de preuve. Il a fallu le signalement de maltraitance effectué par l’école pour déclencher la procédure.
Nous prîmes donc contact avec l’école pour avoir plus d’informations. Nous fûmes reçus par la directrice, et les institutrices de Maëva et de Benoît.
Ce sont ces trois femmes courageuses qui donnèrent l'alerte. Elles nous expliquèrent que leur inquiétude remontaient à bien longtemps, la petite Maëva devenant complètement apathique au fil des jours, autiste dirent-elles.
Elles l’avaient connue gaie et vive comme tous les autres enfants au début de l’année scolaire puis, petit à petit, elles l'avaient vue s’enfermer dans le mutisme et changer complètement de comportement ; parfois Maëva prenait un livre et le lâchait devant elles, sans raison, comme un appel au secours. La métamorphose les avait inquiétées d'autant plus que la fillette était souvent marquée d’hématomes à l'oreille et sur le visage.
Maëva était souvent absente sans justification, aussi lorsqu’elle retrouva la classe après une nouvelle absence en présentant des traces de coups estompées, les institutrices décidèrent d'intervenir et de signaler le problème.
Je ne me souviens pas de leur cheminement, si elles s’adressèrent à la gendarmerie ou aux services sociaux, mais je pense que c'est la gendarmerie qui fut alertée, car les services de l’ASE auraient sans doute encore biaisé pour ne pas enlever la petite à sa famille d'accueil.
Pour expliquer les dernières traces de coups, l'assistante maternelle raconta que la fillette était tombée du toit d'une petite cabane : ce fut la dernière version des sévices infligés à Maëva...
Je questionnais les institutrices sur les rapports entre Benoît et sa petite sœur, puisque l’une des versions de l’ASE faisait état d'un problème entre eux. Elles nous assurèrent que les enfants s'entendaient parfaitement.
Il apparut dans la conversation que nous étions tous en accord sur les soupçons de maltraitance, mais les institutrices nous affirmèrent ne pas pouvoir réellement la dénoncer faute de preuve. Leur démarche fut d’alerter mais elles ne purent aller plus loin.
XIX
Maëva vivait donc maintenant dans un foyer de l’enfance à Avignon. Sa mère dut attendre quelques semaines pour avoir enfin le droit de lui rendre visite, j’étais à ses cotés la première fois que nous revîmes sa fille.
L’accueil que nous fit Maëva fut des plus froids, mais comment lui en vouloir ? De son point de vue d’enfant, nous étions probablement aussi coupables que tous ces adultes qui la martyrisaient. Il n’y avait pas de moyens d’expliquer à une fillette de quatre ans qu’il existait des lois et des procédures, et que malgré notre volonté, nous ne pouvions rien faire pour l’extraire de ce lieu. Ce jour-là nous avons passé quelques heures avec elle. Au fil du temps, Maëva s’adoucit sensiblement ; elle passa un long moment sur la balançoire que sa mère et moi poussions à tour de rôle, et nous réussîmes à la faire rire lorsque la balançoire s’envolait un peu trop haut. Mais ces courts instants de joie se transformèrent en souffrance quand il fallut prendre congé : Maëva éclata en sanglot s’accrochant à nous, refusant de nous laisser partir sans elle. Ce fut un véritable crève-cœur, nous avions le sentiment de l’abandonner à son sort.
Sur le chemin du retour nous n’échangeâmes pas un mot, la tension était à son comble et de toute façon j’avais la gorge si nouée que je n’aurais rien pu dire.
Ce triste scénario se répéta ensuite à chacune de nos visites.
La nuit qui suivit ces premières retrouvailles, je ne trouvais pas le sommeil : comment l’aurais-je pu ? Tout mon esprit était occupé par cette séparation déchirante. J’enrageais, je pleurais de désespoir, il aurait été si simple de nous laisser emmener Maëva, de lui permettre de retrouver la douceur de la Passiflore ; son petit lit l’attendait encore dans sa chambre, je n’avais pas eu le courage de l’enlever, pas tant que tout espoir ne fut perdu. Et pourtant jour après jour, l’espoir fuyait, et plus le temps passait plus il fuyait.
Je ressentais au plus profond de moi la souffrance de Maëva, éloignée de notre amour, placée dans cette famille qui l’avait tant malmenée, puis, pour finir, dans ce centre où elle devait se poser mille questions.
Je pensais à ma mère aussi, qui avait bien connu les enfants. Maman, c’est aussi pour toi que j'écris ce témoignage, toi dont le regard là-haut ne peut qu'être objectif et bienveillant. Tu sais combien un enfant à besoin d'amour et de stabilité... Maman, souviens-toi des jours heureux lorsque nous venions te voir au bord de la mer, et que nous ramassions des coquillages sur la plage avec les petits ; comme ils étaient pétillants de joie ces enfants-là que tu recevais avec tant d’amour, comme les tiens.
Désormais je n’avais plus d’agrément, et reprendre Maëva et Benoît par la voie des services sociaux était exclu. Cette situation était ubuesque : il y avait deux enfants à la recherche d’un foyer, il y avait une famille prête à les accueillir avec amour, il y avait une mère désespérée de savoir ses enfants séparés.
La solution était si simple, que l’esprit tordu des services sociaux et leurs règlements absurdes ne pouvaient la concevoir. Comment pouvaient-ils imaginer qu’il aurait simplement suffi de me confier Maëva et Benoît pour que tout à coup, comme par magie, s’efface un peu de souffrance de la surface du globe ? Non, ils ne pouvaient pas le concevoir, Dieu ne leur avait pas accordé le don de compassion, ni celui du bon sens semblait-il.
Dommage. Dommage pour les enfants qui vivaient désormais séparés, dommage pour Benoît qui était toujours aux mains d’une femme dangereuse, dommage pour Maëva qui était seule dans un univers sécurisé, mais sans amour, dommage pour leur mère qui n’avait jamais souhaité une telle issue lorsqu’elle avait confié ses enfants à l’ASE, et dommage pour moi et ma famille qui aurions tout donné pour voir revenir ces deux petits que nous avions appris à aimer comme les nôtres.
Mais c’était ainsi : le rouleau compresseur de l’administration toute puissante était à l’œuvre, nivellement par le bas, l’important étant de sauver les meubles, point de place pour les sentiments, ici on travaille la matière première et elle ferait mieux de rendre grâce pour les bienfaits que l’on daigne lui accorder plutôt que de geindre et de réclamer du sentiment. Ici les professionnels sont au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon, et surtout qu’aucune tête ne dépasse, tout le monde dans le rang et pas de simagrées, les sentiments ce n’est pas bon pour le mécanisme, les larmes oxyderaient les rouages.
XX
Les mois passèrent. La mère de Maëva décida de reprendre sa fille, et elle y parvint au bout de quelques temps ; malheureusement cette nouvelle charge fut trop difficile pour elle, et finalement elle me confia qu’elle ne souhaitait pas garder Maëva pour toujours.
Il existe une procédure dite de « tierce personne digne de confiance » qui m’aurait permis de prendre la fillette chez moi, je l’expliquais à la mère de Maëva qui en accepta le principe. Mais les démarches longues et compliquées la découragèrent, et elle finit par abandonner ce projet.
Je ne connaîtrai jamais la véritable raison de cet échec, peut-être a-t-elle craint de perdre quelque chose, son autorité parentale, l’amour de sa fille ?
Je l'accompagnai plus tard au tribunal devant le juge des enfants. Elle avait été convoquée pour faire connaître son choix de reprendre ou non la garde de Benoît. On lui avait fait comprendre qu'ayant placé elle-même ses enfants depuis plusieurs années, elle devait désormais choisir de les garder près d'elle, ou de les confier à la tutelle de l'Etat et des services sociaux. J’étais à ses côtés sur les bancs de la salle d'attente, mais je n’ai pas su ce qu’elle dit aux juges ce jour là. Quand elle ressortit elle m'annonça qu'elle ne reprendrait pas Benoît. Je n'en sus pas plus.
C’est chez moi que je vis les enfants les dernières fois ; leur mère accepta qu’ils passent de temps à autre un week-end à la Passiflore, mais pour Benoît, dans le plus grand secret puisqu’il était toujours à la charge de la famille d’accueil.
Maëva se portait beaucoup mieux, elle devenait une jolie petite fille ; ses cheveux, qui avaient été coupés très court, au grand désespoir de sa maman, avaient repoussé. Jade et Flore la coiffaient à tour de rôle et elles retrouvèrent leur complicité d’autrefois.
Néanmoins son regard et ses sourires étaient mélancoliques et j'eus le sentiment qu’ils le resteraient longtemps. Quant à Benoît, il vivait encore dans la famille maltraitante, et il en faisait voir de toutes les couleurs à sa mère lorsqu’il passait un week-end chez elle.
Il ne nous parla pas de ses problèmes, mais son mutisme était éloquent. Il lui faudra presque vingt ans pour pouvoir enfin libérer sa parole.
Maëva retourna bientôt vivre dans une nouvelle famille d’accueil. Ainsi le frère et la sœur ne vécurent plus jamais ensemble durant leurs jeunes années, eux qui étaient si proches à leur arrivée à la Passiflore. Les services sociaux, en les enlevant de chez nous, brisèrent à tout jamais leur complicité enfantine.
J’ai essayé de revoir Maëva dans sa nouvelle famille, mais l’assistante maternelle voulut au préalable en référer aux services sociaux ; chargée de mon passif à l’ASE je fus sûre de leur refus et j’abandonnais l’idée. Quelle curieuse réaction tout de même, que de devoir demander la permission pour une visite à une enfant.
Je tentai encore une fois de suivre le cheminement des enfants, mais leur mère changea de région et ne me donna plus de nouvelles.
Je finis par perdre leurs traces.
DEUXIEME PARTIE
“Faites le premier pas avec foi. Il n’est pas nécessaire de voir l’intégralité du chemin. Faites juste le premier pas...” Martin Luther King
Les premiers pas... on croit à tort qu’on les a fait il y a longtemps, mais dans les faits, la vie ressemble beaucoup plus à une succession de premiers pas qu’à une randonnée assurée menée de pied ferme...
On y fait toutes sortes de premiers pas : des premiers pas à deux, des premiers pas de danse, des premiers pas qui effraient, et d’autres qui amènent la chance...
Et tous ces pas, bout à bout, premiers, seconds, inédits ou répétés nous font avancer... jour après jour... Laurence Witko
Où l’on s’aperçoit que l’assistante sociale n’œuvrait pas dans le social.
I
Les chevaux renâclaient et piaffaient dans l’écurie. Chloé et Nadia étaient occupées à les étriller, elles aimaient ce travail ; le contact avec la force tranquille des animaux avait quelque chose de réconfortant. Elles connaissaient chaque cheval par son nom, et chacun avait son caractère qu’il fallait respecter, du plus doux au plus vigoureux.
Chloé était l'aînée, à l’âge de onze ans, orpheline et fugueuse, elle avait été placée dans ce foyer le L.R. Aujourd’hui elle débutait sa cinquième année dans ce lieu. Nadia avait tout juste treize ans et n’était là que depuis quelques semaines.
Dès son arrivée Chloé l’avait prise en affection, parce que la fillette lui rappelait sa petite sœur du même âge qu’elle n’avait plus revue depuis que les services sociaux les avaient séparées. Chloé s’était débrouillée pour que Nadia soit installée près de son lit dans le dortoir des filles et elles devinrent vite inséparables.
Le L.R était un lieu de vie expérimental en faveur de l’enfance protégée. Le caractère expérimental résidait dans la volonté de mettre des enfants en grande difficulté au contact des chevaux, pour aider à leur éducation. Les pensionnaires étaient, entre autre, chargés du bien être des animaux. Le foyer était situé dans un cadre agréable un peu à l’écart du village, et les enfants avaient tout loisir pour s’épanouir.
Chloé s’éloigna de l’écurie pour apporter de la litière fraîche ; les bottes de paille pesaient au bout de la fourche, mais la jeune fille avait désormais suffisamment de force pour accomplir ce travail. Elle remplit la brouette et retourna vers l’écurie. Mais Nadia n’était plus seule, le régisseur était près d’elle. Chloé sentit son cœur battre plus fort et sa poitrine se serrer. Elle s’approcha doucement, l’homme était de dos et ne la sentit pas venir.
- “ Tu ne t’y prends pas bien, dit-il à Nadia en saisissant la main qui étrillait le cheval, il faut être plus douce.”
Il accompagna le mouvement de la fillette sur les flancs de l’animal et lui imprima un rythme plus lent. Tout en parlant, il se rapprocha d’elle jusqu’à la presser de son corps. Nadia gênée de ce contact tenta brusquement de se dégager, et le cheval effrayé par ce mouvement fit un écart qui la projeta dans les bras du régisseur. L’homme en profita pour la serrer contre lui, ses mains parcouraient maintenant le corps de l’adolescente qui, cette fois-ci, se débattit plus violemment. Mais l’homme était bien plus fort et il la repoussa contre le cheval lui interdisant tout mouvement. Ses caresses se firent plus pressantes.
- “ Laissez-la tranquille ”, hurla Chloé.
L’homme lâcha la fillette et se retourna vivement, les yeux brillant de méchanceté. Il marqua un temps, puis il se précipita sur Chloé, la main levée prête à frapper. Mais Chloé fut plus vive et elle s’éloigna d’un bond ; la fourche en main, les piques dirigés vers le régisseur elle le défiait, mais elle manquait d’assurance et tremblait d’émotion. La colère qui montait en elle fit jaillir des larmes et sa vue se brouilla un instant.
- “ Ne la touchez pas, vous n’avez pas le droit ! ” s’écria-t-elle dans un sanglot.
Le régisseur eu un rire sinistre, et d’un geste rapide et assuré il désarma Chloé, puis la saisissant à la gorge, il la poussa violemment contre le mur et maintint fermement sa prise. La jeune fille comprit qu’elle était vaincue, l’homme était bien trop fort. Elle le sentit peser de tout son poids.
- “ Je suis votre éducateur et je fais ce que je veux de vous “, dit-il dans un murmure à l’oreille de Chloé qui suffoquait.
L’homme parcourut de sa main libre le corps de la jeune fille et s’arrêta un instant sur son sein.
- “ Tu sais ce qu’il faut faire si tu veux que je laisse la petite tranquille”, conclut-il. Puis il lui rendit sa liberté.
Il leur jeta un dernier regard plein de mépris et s’éloigna.
Chloé prit une grande respiration, et dès que l’homme fut hors de vue, elle prit Nadia dans ses bras et la serra très fort. La fillette éclata en sanglots.
- “ Ne le laisse jamais te toucher Nadia, promets-le-moi, ne le laisse jamais te salir. ”
II
Il n’y avait plus un bruit dans le dortoir. Toutes les filles étaient endormies. Chloé entendait le souffle régulier de la respiration de Nadia. La fillette avait eu du mal à trouver le sommeil malgré la présence rassurante de son amie. Chloé se redressa doucement et chercha du pied ses chaussons dans l’obscurité ; lorsqu’elle se leva le lit grinça légèrement ; Chloé se retourna vivement vers Nadia craignant de l’avoir réveillée, mais la fillette dormait profondément. Alors, comme une ombre, elle sortit du dortoir, puis du bâtiment, et longea le mur de clôture qui conduisait à la petite maison située à l’extrémité du terrain. Ses pas étaient assurés, car ils connaissaient bien ce chemin qu’ils parcouraient assez régulièrement depuis quelques mois, mais Chloé ressentait une boule dans son ventre, un mal qui l’accompagnait à chaque fois qu’elle était contrainte de cheminer ici.
La petite maison était éclairée. Une lumière glauque traversait les carreaux sales de la porte vitrée et projetait sur le sol une flaque blanchâtre. Chloé hésita un instant, mais le souvenir de l’homme caressant Nadia dans l’écurie était insupportable, alors elle ouvrit la porte et se glissa à l’intérieur. L’homme l’attendait un verre d’alcool à la main.
- “ Éteins la lumière et approche “, lui ordonna sèchement le régisseur.
III
Marie, jeune officier de police, observait la jeune femme dont elle enregistrait la déposition. Elles avaient le même âge, c’est ce qu’avait noté Marie sur le procès verbal, mais la jeune femme qui se nommait Chloé, semblait plus mature. Son visage était joli et agréable mais elle devinait dans ses traits la dureté de ceux que la vie a malmenés.
Marie écoutait attentivement son récit et ce qu’elle entendait la mettait mal à l’aise. Elle en avait déjà entendu d’autres dans sa jeune carrière, mais cette fois-ci quelque chose la troublait.
Chloé s’exprimait un peu confusément et avec beaucoup d’émotions, parfois des larmes coulaient sur ses joues sans que son visage n’exprime de douleur, comme si, après les avoir tenues closes durant des années, elle pouvait enfin ouvrir les vannes de son cœur, au fur et à mesure que sa parole se libérait.
Les faits qu’elle relatait avaient eu lieu des années auparavant, alors qu’elle n’était qu’une enfant et qu’elle vivait au foyer L.R. Ce qu’elle racontait était effroyable ; Il était question d’agressions sexuelles, de viols, de prostitution.
Elle affirma qu’elle ne fut pas la seule victime de ces sévices, mais que de nombreuses jeunes filles avaient vécu plus ou moins la même chose, « nous étions plus d’une trentaine, précisa-t-elle, des filles pour la plupart, mais aussi quelques garçons, nous étions tous des enfants en grande difficulté, il le savait et il en profitait ».
Elle désigna le coupable, un homme, Monsieur S. Chloé se tut un instant. Elle sentit un ancien trouble l’envahir, un sentiment d’angoisse et de peur refit surface à l’énoncer du nom de son bourreau, et un mal qu’elle avait connu naguère se manifesta de nouveau sous la forme d’une boule dans le ventre.
Marie perçut son malaise et lui proposa de faire une pause, mais la jeune femme se reprit et préféra continuer son récit de peur que le courage ne lui manqua ensuite.
- « Cet homme m’a violée durant des mois, reprit-elle, je suis tombée enceinte, j’avais seize ans et ils m’ont fait avorter.
- Ils ? demanda Marie, il y a donc plusieurs protagonistes ?
- Oui, il y a cet homme et la directrice du foyer ; c’est la femme qui m’a emmenée avorter en cachette.
La jeune femme marqua un silence puis elle reprit son récit et Marie ne l’interrompit pas. Elle raconta des soirées sordides où son bourreau se livrait à des pratiques abominables sur des jeunes filles apeurées et sans défense. Elle parla aussi de cette période durant laquelle les dirigeants du foyer l’avaient prostituée en Belgique. L’homme était violent, il frappait les plus faibles et aucune ne lui résistait. La jeune femme parlait les yeux baissés comme si elle avait honte de ce passé, comme si elle en était aussi coupable, mais à la fin de son récit elle planta son regard dans celui de Marie, un regard profond et déterminé.
- « je sais, dit-elle, que les faits de viols prescrits peuvent faire l’objet de poursuites si la victime les déclare avant l’âge de vingt-huit ans, j’atteindrai cet âge dans quelques semaines et je veux que ma plainte soit enregistrée. »
Chloé signa rapidement le procès verbal. Le document portait la date du mois de juin 2001.
Après son départ, Marie resta un long moment perdu dans ses pensées ; elle se disait qu’elle-même avait eu de la chance, sa jeunesse avait été douce, elle avait eu une enfance heureuse et s’était épanouie dans une famille unie, alors que durant la même période cette jeune femme vivait le martyr dans un foyer. Cette différence de traitement qu’imposait la vie l’avait toujours étonnée; pourquoi était-ce ainsi ? Pourquoi certains vivent dans le bonheur alors que d’autres sont dans la souffrance?
La souffrance, Marie la côtoyait quotidiennement dans son travail, mais lorsqu’elle le quittait pour rejoindre sa famille, son compagnon et leur petite fille, elle l’oubliait et refaisait le plein de bonheur en quelques heures. Mais pour cette jeune femme qui avait vécu si longtemps l’innommable, combien de mois, d’années, de décennies, seraient nécessaires pour faire le plein de bonheur ?
L’arrivée de son chef de service la tira de sa réflexion. Marie lui tendit le procès verbal qu’il parcourut avec attention ; l’homme changeait de teint au fur et à mesure qu’il progressait dans sa lecture. Quand il eut terminé, le vieux policier resta un moment silencieux le regard perdu, puis il se tourna vers sa jeune collègue.
- « Bon sang Marie, vous savez ce que cela signifie ? C’est une sale affaire ; tout ceci est abject. Que Dieu nous épargne de telles ignominies, d’en être les victimes ou les bourreaux !
IV
L’enquête prit rapidement un bon rythme ; le principal suspect Monsieur S. était déjà connu de la justice, il fut facile de retrouver sa trace. Il avait été condamné deux fois pour des faits de proxénétisme aggravés, enlèvement de mineure, vols et destruction, bien avant son arrivée au L.R.
Qu’un individu lesté d’un tel passé ait pu se voir confier une mission près de jeunes filles, intriguait Marie ; il était évident qu’il avait bénéficié d’appuis et la jeune enquêtrice entendait bien éclaircir ce point.
Le L.R. ferma ses portes en 1991 soit dix ans avant les débuts de l’enquête. Une des priorités des enquêteurs fut de tenter de retrouver la trace des anciennes pensionnaires pour corroborer la déposition de Chloé.
Cela prit énormément de temps. Les archives du foyer avaient été détruites après les dix ans légaux, par la directrice elle-même, et curieusement il n’y avait aucune trace du passage des adolescentes dans les archives des services sociaux, ni dans ceux du conseil général censé être l’organisme de tutelle du foyer, si ce n’est une liste anonyme précisant simplement le sexe et l’âge de trente-six pensionnaires.
Néanmoins avec un peu de persévérance, d’autres jeunes femmes qui vécurent sur les lieux furent retrouvées. Quatre d’entre elles choisirent de déposer plainte contre S. pour les mêmes faits que ceux qui lui étaient déjà reprochés. L’étau se resserrait autour du bourreau.
Restait à établir le lien entre S. et la directrice du foyer. Il apparut que les deux suspects étaient amants au moment des faits. Ils s’étaient rencontrés trois ans avant l’ouverture du foyer, alors que S. sortait de prison après avoir purgé une peine pour proxénétisme.
La femme était alors une assistante sociale en disponibilité du conseil général. Plus tard le couple décida d’ouvrir une structure d’accueil pour des enfants difficiles ; ainsi naquit le foyer L.R.
En raison du lourd passé de S. l’agrément fut refusé au couple par la préfecture, mais le L.R. ouvrit tout de même et des enfants lui furent confiés par les services sociaux, selon la procédure de tierce personne digne de confiance qui fut accordé à la directrice, alors assistante sociale bien notée des services.
C’est aussi la directrice qui se montra garante de son amant et qui prétendit lors de l’enquête administrative qui eut lieu à l’ouverture du foyer, que S. s’était racheté une conduite et que désormais il voulait se mettre au service des autres.
Les premiers pensionnaires arrivèrent donc en 1984.
Le foyer ne fit plus parler de lui jusqu’au début des années 90 lorsqu’une jeune pensionnaire déclara des faits de viols au parquet de Carpentras. Mais cette plainte n’aboutit pas.
Néanmoins quelques mois plus tard le foyer cessa son activité. Les pensionnaires furent dispersés, les archives détruites, et une chape de plomb déposée sur le passé du L.R. C’est la plainte de Chloé qui relança la procédure, à quelques mois seulement de la prescription des crimes.
Début 2002, le parquet de Carpentras décida l’arrestation des deux protagonistes : Monsieur S. et son ex-maîtresse, directrice du foyer au moment des faits.
Le procureur de la République fit alors une déclaration à la presse en annonçant « une nouvelle affaire Emile Louis », faisant référence à cette affaire abominable de sinistre mémoire.
V
- « As-tu lu la presse du jour ?
C’était mon amie Johanne qui me téléphonait. Elle fut l’un de mes principaux soutiens lorsque j’avais tenté de défendre Benoît et Maëva à l’époque où je vivais à la Passiflore. J’avais quitté les lieux et changé de vie quelques années après avoir perdu la trace des enfants, mais j’étais toujours en contact avec les amies que j’avais laissées là-bas. Johanne avait suivi toute l’affaire, elle connaissait les enfants pour les avoir très souvent rencontrés à la Passiflore et elle avait été bouleversée du mauvais sort qu’ils subirent, et bien que nous n’ayons plus reparlé de ces moments douloureux depuis des années, elle n’avait rien oublié.
- “ Il y a un article dans le journal La Provence qui devrait t’intéresser “, me dit-elle d’un ton mystérieux.
La manchette du journal affichait dans son édition du vingt-neuf janvier 2002 : « l’assistante sociale charge son amant ». L’article exposait des faits graves de viols sur mineures ayant eu lieu au foyer “L.R” entre 1986 et 1991. « L’ancienne directrice Madame D. » …mon sang ne fit qu’un tour et je dus m’asseoir pour ne pas tomber ; « L’ancienne directrice Madame D. aujourd’hui assistante sociale et cadre à l’ASE a été écrouée en compagnie de son amant Monsieur S., pour viols et complicité de viols ».
Madame D. était en prison ! Cette femme, qui avait fait souffrir Benoît et Maëva en refusant obstinément d’écouter mes plaintes, qui m’avait fait souffrir en me retirant ces enfants que j’aimais, et qui m’avait aussi accessoirement mise en difficulté en me retirant mon agrément et donc privé de travail, cette femme qui incarnait à elle seule ce que je détestais le plus : la méchanceté, et bien cette femme était désormais derrière les barreaux.
Ce qu’on lui reprochait était épouvantable et j’en eus des frissons d’effrois en pensant que mes petits protégés étaient passés tout près de l’enfer, même si ce qu’ils vécurent n’en était guère éloigné. Benoît et Maëva avaient été placés en 1992, le foyer L.R ferma un an auparavant ; je n’osais imaginer ce qu’aurait été le sort de Maëva si les choses avaient tourné différemment et que le foyer fut toujours en activité quelques années plus tard.
La fin de l’article évoquait la plainte d’une ancienne pensionnaire du L.R, âgée aujourd’hui de vingt-huit ans, qui avait été violée par S. durant les cinq années qu’elle passa au foyer ; il était aussi question de plusieurs autres jeunes filles qui déclaraient avoir subi les mêmes sévices.
J’étais abasourdie ; je sentais gronder la colère et l'écœurement. Comment des êtres aussi vils avaient-ils pu obtenir les agréments nécessaires à l’ouverture d’un foyer, puis pour Madame D. obtenir ce poste clé à l’ASE qui lui donna tout pouvoir sur des enfants innocents ?
Je me souvenais des tracasseries que les services de l’ASE nous imposèrent avant de nous délivrer notre agrément. Leurs investigations étaient tout de même assez poussées, alors comment expliquer que S. et Madame D. aient pu passer ainsi par les mailles du filet ? Quelles ficelles Madame D. avait-elle tirées ensuite pour parvenir à grimper d’une manière aussi fulgurante à la tête de l’Unité Territoriale ?
Décidément mon estime des services sociaux, déjà au plus bas depuis mes démêlés avec eux, chutait dans une zone proche du zéro absolu. Ils auraient mieux fait, les grands chefs de la commission qui m’avaient écoutée avec condescendance, de balayer devant leur porte plutôt que de me faire la morale ; les dysfonctionnements de leurs services étaient sans nul doute responsables de ce fiasco et j’espérais bien que le procès qui s’annonçait les mettrait en lumière.
Soudain j’eus la conviction qu’il fallait que je dise ce que je savais de tout cela, il le fallait par égard pour ces jeunes femmes courageuses qui se battaient pour que justice leur soit rendue, et aussi pour Benoît et Maëva qui avaient soufferts de ces sombres personnages.
J’envoyais donc une lettre au procureur de la république au tribunal de Carpentras.
VI
C’est à la suite de ce courrier que je rencontrais Marie. La jeune enquêtrice avait été chargée de collecter les témoignages de tous ceux qui eurent affaire à Madame D. ces dernières années. Une copie de ma lettre au procureur lui était parvenue et elle souhaita me rencontrer. Elle vint me voir aux premiers jours d’avril.
Marie me plut tout de suite, elle n’avait rien du stéréotype des policiers que j’avais rencontré jusque-là ; elle était jolie, charmante, et nous sympathisâmes rapidement. Mon témoignage n’était pas en lien direct avec l’affaire du foyer L.R., mais Marie m’expliqua qu’il lui importait d’en apprendre plus sur la personnalité de Madame D.
Je lui racontais alors dans le détail mes démêlés avec l’ex-chef de l’unité territoriale du Comtat, son refus d’admettre la maltraitance sur Maëva, et les pressions qu’elle avait exercé pour tenter de faire cesser nos signalements à l’ASE. Je n’avais plus évoqué ces moments douloureux depuis des années, mais ils étaient toujours présents et l’émotion me gagna quand je parlais des enfants.
Marie m’écoutait sans m’interrompre, parfois elle hochait la tête d’approbation lorsque j’expliquais les carences de l’ASE. C’était la première fois qu’un représentant officiel prenait vraiment en considération mes remarques. Cela arrivait un peu tard sans doute, mais cela me faisait du bien ; j’imagine ce que doivent ressentir les victimes de violences lorsqu’un tiers manifeste sa compréhension et qu’elles ont le sentiment d’être enfin crues. Les choses auraient été si simples si j’avais eu la chance d’être entendue naguère comme je le fus cette fois par Marie. Qui sait comment la situation aurait évolué, peut-être que les enfants seraient revenus à la Passiflore, nous y serions sans doute toujours, baignant dans le bonheur.
Je me laissais aller à mes rêveries, mais Marie me ramena à la réalité. Elle me questionna sur un lien éventuel entre la famille qui avait maltraitée Maëva, et Madame D. Marie trouvait étrange que cette famille ait impunément agit de la sorte. Il lui sembla qu’elle avait sans doute bénéficié d’un soutient à l’ASE ; le poste occupé par Madame D. et les responsabilités dont elle disposait, orientèrent la réflexion de l’enquêtrice sur un probable soutient de Madame D. Mais quel pouvait être le mobile d’un tel soutien ? Marie me promit d’enquêter sur ce point.
Elle m’informa également qu’il était possible que je sois amenée à prendre la parole à la barre afin de relater mon histoire. L’idée me déplaisait. Penser qu’il me faudrait faire face à un jury, des juges et surtout les accusés m’effrayait. Cependant, je l’aurais volontiers accepté si mon témoignage était jugé nécessaire à l’éclairage de la vérité. Après tout, j’avais choisi de mon propre chef d’écrire au procureur. Lorsque j’avais rédigé ce courrier, j’étais à peu près certaine qu’il resterait sans réponse, et la visite d’une enquêtrice m’avait beaucoup étonnée.
- « Quoiqu’il arrive suivez ce procès, me dit Marie en prenant congé, ce que vous apprendrez vous surprendra ».
VII
Françoise observait Pierre qui était immobile depuis de longues minutes. Elle avait vu l’état psychologique de son époux se dégrader au fil des jours et elle commençait à s’en inquiéter. Depuis qu’il avait été tiré au sort pour être l’un des jurés au procès du foyer L.R., Pierre semblait avoir vieilli d’un coup. Les bras croisés sur la table devant son assiette, le retraité avait le regard dans le vague.
-” Mange ta soupe avant qu’elle ne refroidisse “ dit Françoise du ton le plus doux qu’elle trouva.
Pierre revint brusquement à la réalité, mais il lui fallut tout de même un instant pour réaliser qu’il était confortablement installé chez lui. Il sourit à sa femme. Les deux époux mangèrent en silence. Françoise d’ordinaire si bavarde ne savait plus comment engager la conversation. Pierre sentait bien au fond de lui-même, que son épouse souffrait autant que lui de cet état d’abattement qui l’avait saisit dès les premiers jours d’audience, mais il ne savait pas comment s’en défaire ; tout juste espérait-il qu’il disparaîtrait comme il était venu dès demain, après la fin de ce douloureux procès.
Pierre avait eu une vie calme. Après des années de bons et loyaux services dans la fonction publique, il avait pris sa retraite et vivait paisiblement avec Françoise à Carpentras. Tout au long de sa vie il n’avait jamais été confronté à l’adversité ; il n’avait pas vécu la guerre, ses enfants se portaient bien, il était grand-père depuis peu, tout allait pour le mieux. Les seuls moments difficiles qu’il avait vécu étaient les décès de ses parents, mais bien qu’il en ait eu beaucoup de peine, ces disparitions étaient dans l’ordre des choses et il avait fait son deuil. Il n’avait donc jamais été directement confronté à la souffrance. Celle qu’il voyait sur les images de son téléviseur le bouleversait parfois, mais ce n’était pour lui qu’une vue de l’esprit, la compassion qui le saisissait n’était qu’une construction intellectuelle, motivée uniquement par son éducation et sa moralité. Il avait de la chance et il le savait, sa destinée lui avait jusque-là épargné de regarder la laideur dans les yeux.
Et puis il avait été choisi comme juré d’assise, et tout avait basculé. Dès les premières minutes cette fonction l’avait mis mal à l’aise. Pierre était un homme gentil, il n’aurait pas fait de mal à une mouche, et l’idée qu’il pouvait être amené à envoyer des gens en prison l’horrifiait.
Lorsque les accusés pénétrèrent dans la salle d’audience, Pierre se sentit embarrassé ; ils étaient à cent lieues de l’idée qu’il s’était forgée des deux criminels, l’homme était séduisant et la femme élégante, ils n’avaient pas le physique de l’emploi. Pierre pensa que ces gens auraient très bien pu être des amis. Néanmoins à l’énoncé des faits il déchanta et les trouva soudain très antipathiques. Cette succession de sentiments opposés qu’il éprouva ne fut que le début d’un vaste chamboulement de son esprit qui le perturba beaucoup, et qui le conduisit à l’abattement tout au long du procès. Il lui semblait être dans les montagnes russes, tantôt observant les choses depuis un sommet et quelques instants après les regardant du plus profond d’un creux.
Le moment le plus difficile fut le témoignage des victimes. Ce qu’elles racontèrent le remplit d’effroi ; l’une d’elle l’avait particulièrement touché parce qu’elle lui rappelait sa propre fille. Elle raconta tout ce que lui avait fait subir S. et ce qu’elle disait était innommable ; la jeune femme sanglotait tout en s’exprimant et son témoignage était particulièrement poignant. Un instant elle se tourna vers les jurés et Pierre croisa son regard. Ce qu’il y lut le bouleversa ; de toute sa vie il n’avait jamais vu autant de détresse dans un regard. Il lui sembla que le cours du temps s’arrêta durant cet échange ; cet instant de grâce lui fut accordé pour comprendre le cœur de la jeune femme. Pierre reçut le message comme un coup de poing en pleine figure, qui le sonna et le laissa tant étourdi que son discernement fut altéré. Il lui fallut de longues minutes pour retrouver ses sens. Quand il se reprit enfin, il dirigea son regard vers les accusés. S. ne semblait pas s’intéresser aux débats, Madame D. quant à elle, observait froidement la jeune femme qui essuyait ses larmes d’un revers de main. Aucun des accusés ne manifestait ni remords ni compassion. C’est alors que Pierre comprit enfin ce que signifiait la laideur, pour la première fois de sa longue existence il la voyait dans toute sa gloire et ce qu’il découvrait lui donnait envie de vomir. Il ne put s’empêcher de se laisser envahir par une vague de colère qui monta du plus profond de son être et qui le submergea totalement.
Alors comment rester serein après une telle expérience ? Comment regarder de nouveau la vie sous son bon côté ?
Pierre mangeait sa soupe en silence et ne savait plus que penser ; en revanche il savait très bien ce qu’il ferait demain lors du vote des jurés, car sa conviction était faite désormais.
« La vie sera toujours la plus grande justicière qui soit même si elle tarde souvent à rendre ses sentences. » Daniel Desbiens
Verdict.
VIII
Samedi 12 mars 2005, France-info,
« Le couple, véritable "Thénardier du sexe", S., détenu depuis janvier 2002, déjà condamné à 9 reprises notamment pour proxénétisme aggravé, dirigeant du centre alternatif pour adolescents en difficulté "L.R." à Mormoiron (Vaucluse), a été condamné vendredi à 18 ans de prison ferme par la cour d'assises du Vaucluse pour viols de mineures avec actes de torture ou de barbarie, relations à plusieurs, sodomie, actes de zoophilie et coups, commis dans ce centre. Sa compagne D., 57 ans, présidente de l'association "L.R." qu'elle avait créée en 1984 avec S., a écopé de 10 ans de prison pour complicité. Elle a été arrêtée à l'énoncé du verdict. Une jeune fille arrivée au centre à 9 ans, a subi un avortement à l'âge de 16 ans. 4 jeunes femmes, aujourd'hui âgées d'une trentaine d'années, partie civile, sont toujours prises en charge par des psychologues ».
IX
- « J’ai la réponse à votre question », Marie me téléphonait de son bureau de Carpentras, « je sais ce qui a poussé Madame D. à nier la maltraitance sur Maëva ».
Elle ajouta qu’elle tenait à m’en parler, car elle pensait que cela me soulagerait de comprendre enfin les tenants et aboutissants des déboires que nous connûmes à cause des services de l’ASE.
Marie m’expliqua que tout ce qu’elle allait me dire n’était pas officiel et qu’elle avait agi par curiosité et aussi par compassion. Elle avait été troublée par mon désarroi lors de notre rencontre et elle s’était promis d’essayer de démêler cette affaire. L’enquête sur Madame D. lui avait ouvert quelques portes et Marie en avait profité pour obtenir les informations qui lui permirent de tout comprendre. Elle entreprit un récit que j’écoutais attentivement.
-« Tout commença au foyer L.R., me dit-elle. Une jeune fille nommée Chloé était régulièrement violée par S. qui menaçait, si elle se refusait à lui, de s’en prendre à une autre adolescente de treize ans, Nadia, à laquelle Chloé était très attachée. Cet homme abject se livra sur cette jeune femme à des pratiques innommables que je ne veux pas vous décrire.
Chloé se rendait régulièrement dans la chambre de S. qui soutint lors de l’instruction que la jeune femme était consentante.
J’ai rencontré Chloé plusieurs fois, c’est moi-même qui pris sa première déposition, celle qui a déclenché toute l’affaire. Je peux vous assurer que Chloé n’était pas consentante, elle agissait sous la contrainte et la violence, et elle en porte encore aujourd’hui les stigmates ».
Marie marqua un temps puis reprit : « vous savez nous avons le même âge Chloé et moi, et je comprends parfaitement ce qui l’a motivé à déposer plainte ; je vous assure qu’il faut un sacré courage pour oser affronter l’enquête, les policiers, le procès, mais surtout un passé aussi sordide.
Nombreuses sont celles, parmi les anciennes pensionnaires du L.R. que nous avons retrouvées qui refusèrent catégoriquement de se lancer dans la procédure ; je ne les blâme pas, les faits remontent à plus de quinze ans et la plupart de ces jeunes femmes ont changé de vie, et ne souhaitaient pas replonger dans l’horreur des souvenirs.
D’autres, comme Chloé et les quatre plaignantes qui se sont portées partie civil au procès, ne pouvaient pas imaginer tourner la page sans affronter le passé.
Chloé était donc liée avec Nadia qu’elle considérait comme une sœur, et elle la protégeait de la malfaisance de S. en le laissant agir à sa guise avec elle-même. Ainsi S. violait Chloé régulièrement. Plus tard, avec la complicité de Madame D. il l’envoya en Belgique où elle fut prostituée par un réseau organisé.
Le couple recevait des dividendes de ce « placement » ; ces faits sont avérés et ont été examinés durant le procès. Puis Chloé est tombée enceinte et le couple l’a chassée du foyer après l’avoir fait avorter en cachette. La petite Nadia s’est donc retrouvée seule.
Quelques temps avant son départ, alors qu’elle était enceinte, Chloé se confia à son amie et lui raconta les atrocités que lui faisait subir S., elle lui apprit qu’il était le père de l’enfant qu’elle attendait. Elle lui raconta aussi qu’elle était effrayée à l’idée de l’avortement qu’avait programmé Madame D.
Son amie partie, la solitude pesa sur Nadia et elle trouva le réconfort auprès d’une autre pensionnaire, Nadège. Elles devinrent amies, pas au point toutefois d’être aussi proche qu’avec Chloé. Celle qu’elle considérait comme sa grande sœur lui manquait et sans sa protection elle avait peur de la menace que représentait S.
Chloé lui avait fait promettre de ne pas le laisser la toucher, mais l’adolescente était terrorisée, aussi tenta-t-elle de se faire une alliée de Nadège en lui racontant tout ce que Chloé lui avait avoué : les viols, la prostitution, l’avortement.
Malheureusement cette Nadège n’était pas un cœur pur comme Chloé ou Nadia, mais une fille fourbe et violente qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. D’ailleurs S. ne l’avait jamais ennuyée, car il avait bien compris qu’elle lui causerait des problèmes. Les autres jeunes femmes que j’ai interrogées, parlent de Nadège en termes peu flatteurs ; l’une d’elles se souvient d’une altercation où Nadège l’avait violement frappé au visage et lui avait arraché une poignée de cheveux ».
Marie marqua un silence, guettant ma réaction. Des coups, des cheveux arrachés, le L.R., Madame D., tout cela tournait dans ma tête et me donnait le vertige ; je sentais se constituer le puzzle, rien n’était encore très clair, mais je voyais venir la vérité sans toutefois l’appréhender totalement.
Marie reprit son récit : « A la fermeture du foyer, Nadège se maria et eu rapidement un enfant, puis un autre. En 1994 le couple était dans des difficultés financières inextricables, et Nadège, la fourbe, prit contact avec Madame D. Celle-ci entre-temps avait repris son ancien métier d’assistante social et grimpé dans la hiérarchie des services sociaux au point d’être devenue en peu de temps chef de l’unité territoriale du Comtat. Nadège la fit chanter et lui demanda de l’argent en la menaçant de révéler tout ce qu’elle savait de leurs agissements avec les pensionnaires du L.R.
Madame D. était prise au piège, aussi lui proposa-t-elle de lui « fournir » deux petits enfants et les indemnités qui allaient avec, pour faire cesser le chantage. C’est ainsi que vos petits protégés vous ont été enlevés pour être jetés dans les mains viles et cupides de cette méchante femme».
La suite de l’histoire je la connaissais et désormais je comprenais tout.Ainsi donc Maëva avait été maltraité par une femme qui dans sa jeunesse avait elle-même subi des violences ; malheureusement ce schéma est banal.
Madame D. victime à son tour du chantage de Nadège ne pouvait faire autrement que de couvrir ses actes de maltraitance. Elle y était parvenu avec adresse, déjouant toutes mes tentatives pour alerter l’ASE, parce qu’elle occupait un poste qui la plaçait en position de force pour articuler ses machinations sans se faire démasquer.
Benoît et Maëva avaient simplement joué de malchance ; ils furent mêlés malgré eux à une histoire qui ne les concernait pas. Au même titre d’ailleurs que toutes les victimes de S. et D.
Toutes ces jeunes vies broyées, tout ce gâchis, j’en avais la nausée. Les principaux protagonistes étaient désormais sous les verrous pour longtemps, mais à mon sens tous les coupables n’ont pas payé leurs crimes.
L’ASE toute puissante a-t-elle été inquiétée ? Toutes ces personnalités que j’ai vainement tenté d’alerter ont-elles simplement été questionnées sur leur défaillance ? Et l’assistante maternelle maltraitante, après mon témoignage, lui a-t-on enlevé son agrément, a-t-elle été sanctionnée ? Le grand plan des dieux de l’aide social a-t-il été corrigé ?
J’ai bien peur qu’à toutes mes questions il n’y ait que des réponses négatives.
La justice des hommes est passée et désormais rien ici-bas n’atteindra plus les responsables de ce fiasco. Pourtant je voudrais qu’il me soit fait justice, et qu’il soit fait justice à tous ceux que les services sociaux ont broyés.
Alors que la honte emporte tous ceux qui par stupidité, par lâcheté, par incompétence, par fainéantise ou cupidité, ont jeté dans l’adversité des êtres purs et innocents.
Que les remords tenaillent à jamais, tous ceux qui pour de viles raisons, ont fermé les yeux et se sont bouché les oreilles pour ne pas entendre les cris de détresse des innocents et le sanglot des anges.
TROISIEME PARTIE
" Tout le problème de ce monde c’est que les idiots et les fanatiques sont toujours sûrs d’eux tandis que les sages sont pleins de doutes." Bertrand Russel
Les bleus de l’âme.
I
Ainsi donc Flore avait retrouvé Benoît. Malgré tout, après de si longues années sans contact, je pensais que le lien était rompu et qu’il y aurait peu de chance qu’il se renoue.
Certes nous avions un bonheur passé en commun, mais il avait été bafoué par des tiers sans compassion. Pour moi ce fut assez simple de retrouver l’affection que je portais à Benoît et Maëva, mais qu’en était-il pour eux ? Tout ceci était si loin et ils étaient si jeunes à l’époque que je n’osais imaginer qu’ils aient gardé une mémoire de ces temps heureux partagés à la Passiflore.
Avaient-ils seulement le souvenir de mon nom ? Il y avait fort à parier que ni Benoît ni Maëva n’éprouvent le besoin de me parler, ni de me revoir, et je n’aurais rien pu faire pour les convaincre du contraire.
Mais le cœur des êtres humains ne suit pas de règles logiques, et Benoît saisit la main que je lui tendais.
Une douce relation s’installa alors entre nous, et au fil des messages que nous échangeâmes le lien distendu se resserra.
Benoit commença timidement à me raconter son parcours, puis il prit plus d’assurance et me parla de sa vie actuelle.
Je sentais qu’il tenait aux sentiments qui naissaient entre nous et il m’encourageait à le conseiller sur les décisions qu’il devait prendre dans sa vie. Il me racontait ses amours tumultueuses, sa première compagne, son désir de devenir père pour pouvoir donner à un enfant l’amour qui lui avait tant manqué, puis sa peine quand son couple s’était brisé, et enfin son nouveau bonheur lorsqu’il rencontra Jessica, celle qui devait lui donner l’équilibre qu’il recherchait tant.
Il me parlait sans plus de retenue, comme si nous n’avions jamais été séparés. Ainsi j’appris de nombreux détails de sa vie quotidienne, son installation avec son nouvel amour, et aussi comment Maëva vint vivre avec eux.
Que devenais-je pour lui, une mère de substitution, une grande sœur, une confidente ? Sans doute tout cela à la fois. Je le ressentais au plus profond de moi et cela me touchait infiniment, parce que tout ce que nous avions bâti ensemble à la Passiflore et qui nous avait été dérobé, nous était rendu à présent.
- « Veux-tu que je sois ta marraine, Benoît », lui avais-je proposé dans un élan du cœur ? Il m’avait aussitôt répondu : « je ne demande que ça »…
Le temps avait fait son œuvre et les souffrances étaient apaisées, mais il restait tout de même une dette que la vie devait nous payer et elle était en train de s’en acquitter.
Cela venait un peu tard sans doute, parce que Benoît et Maëva étaient désormais adultes, et que j’arrivais moi-même à l’âge ou la vie offre plutôt des petits-enfants que des enfants, mais cela venait, et je ressentais l’apaisement que procure la justice, la vraie, celle du cœur.
C’est durant cette période d’échanges virtuels avec Benoît et Maëva que j’ai éprouvé le besoin de revenir aux sources, là ou tout commença.
Près de vingt années s’étaient écoulées depuis le départ des enfants. J’avais quitté La Passiflore longtemps auparavant : ma vie sentimentale m’avait emportée vers d’autres rives, et je n’y étais jamais retournée.
Je m’y suis rendue un jour de mai, il faisait un temps magnifique. Les dentelles de Montmirail ciselaient l’azur de leurs dents acérées et les genêts en fleurs embaumaient les alentours.
Certaines choses avaient changé évidemment : la mairie de notre petit village n’était plus au même endroit ; la maison de mon amie Henriette, vendue après sa mort, était en rénovation ; même la petite bâtisse que j’avais occupée avant la construction de la Passiflore ne ressemblait plus à ce qu’elle avait été autrefois.
Les eaux de la Salette avaient beaucoup coulé sous les ponts, et la vie avait fait son œuvre avec plus ou moins de bonheur, mais je retrouvais tout de même les accents de la Provence que j’avais tant aimée, et cela me réjouissait le cœur.
Je suis allée à Suzette voir la petite école où Flore et Benoit furent scolarisés durant quelques temps ; elle était toujours la même avec sa façade ocre et ses petits volets bleu-ciel. Le gros platane trônait encore au centre de la cour de récréation, et projetait l’ombre protectrice de son feuillage sur le gravier, comme un gros bonhomme généreux. Des petits jouaient tout autour, et l’espace d’un instant je crus apercevoir la frimousse de Benoît enfant.
Et puis j’ai franchi le pont qui enjambe la Salette et qui mène à la Passiflore. J’avais le cœur battant parce que je ne savais pas ce qui m’attendait sur l’autre rive.
Ce pont n’est long que de quelques mètres, mais cette distance représentait celle qui me séparait de mon passé.
Ce n’est pas anodin de refaire un chemin à l’envers, il existe toujours un risque de se perdre dans les méandres de la conscience, de sombrer dans la nostalgie ou le désespoir. Mais ce jour là j’étais sereine, je savais que le temps des épreuves était révolu et que rien de méchant ne m’atteindrait désormais ; je cheminais en compagnie de tous ceux que j’avais aimés autrefois et qui ont disparu depuis, mon père, ma mère, ma gentille voisine, mais aussi tous mes amis qui sont encore là et qui m’ont soutenue durant mon combat pour les enfants.
Je n’étais pas seule, j’étais portée par l’amour de ces êtres que j’avais accumulé en moi tout au long de ma vie, et il me protégeait de l’adversité.
Comme j’aurais aimé qu’ils soient tous là en cet instant ; comme j’aurais voulu que tous ceux qui m’avaient tristement regardé quitter la Passiflore, voient aujourd’hui rayonner la joie sur mon visage.
Ce que j’ai trouvé sur l’autre rive de la Salette, sur ce petit chemin de terre qui mène à mon ancienne maison, c’est le sentiment du devoir accompli.
Lors de mon départ, onze ans auparavant, j’avais en moi le goût de l’échec ; je n’étais pas parvenue à sauver Benoît et Maëva de l’enfer dans lequel ils se trouvaient, et pourtant Dieu sait que je n’avais pas ménagé ma peine. Mais, à cette époque, mon heure n’était pas arrivée, c’est ce que je compris ce jour là.
Mon temps viendrait plus tard, alors que les enfants seraient des adultes, et qu’il leur faudrait un témoin de leurs souffrances passées. Quelqu’un qui les aide à comprendre ce que la mauvaise fortune leur avait réservé au début de leurs existences, et qui les débarrasse des haillons de cette jeunesse martyrisée, pour qu’ils puissent enfin construire leurs vies d’homme et de femme avec sérénité.
J’étais ce témoin, j’en avais désormais la certitude ; j’étais celle qui par amour pour eux avait gardé la mémoire de leur histoire.
Le ciel ne m’avait pas réservé le rôle que j’avais envisagé au début de cette aventure. Je n’étais pas devenue une assistante maternelle, une maman de secours, j’étais bien plus que cela, j’étais le maillon qui pouvait assembler le passé et l’avenir de ces deux êtres innocents, et leur permettre de prendre un bon départ dans leur vie d’adulte.
Quel parent ne rêve pas de remplir ce rôle pour ses enfants ?
Ainsi la vie me remboursait au centuple pour l’énergie dépensée, le poids de la souffrance et du désespoir, les larmes et les sanglots, en m’attribuant ce rôle si important pour l’avenir de Benoît et de Maëva. C’est la raison qui m’a poussée à écrire ce témoignage.
La Passiflore était là devant moi ; ce lieu qui avait été pour moi le symbole des années de bonheur, et que j’avais quitté dans la souffrance, me souriait de nouveau, et j’en pleurais des larmes de joie.
Mais il me restait encore une chose essentielle à accomplir : rencontrer les enfants. Cela viendrait plus tard, après avoir entendu et écrit de quelles manières Benoît et Maëva furent tirés d’affaire.
La grandeur des petits.
BENOIT
« J'arrive de bien loin et je vous prie de m'excuser pour le mal que je vous donne. Je suis le reliquat d'une comète vagabonde, un petit cheveu de la comète, rien qu'un brin de soie de l'azur en cavale. Je viens remplir mon temps dans le temps des hommes et je ne sais ni de quoi, ni pourquoi, ni comment je suis fait. Le hasard m'a mis là... » Léo Ferré (Benoît misère)
II
J’ai été surpris par le message de Flore. Tout d’abord j’ai cru à une erreur, mais il était assez précis et me parlait d’un lointain passé ; un nom revint que j’avais oublié : la Passiflore.
Oui je me souvenais, je n’avais pas d’images précises, plutôt des impressions, comme lorsqu’on regarde un paysage à travers une vitre embuée. Je voyais des lumières aux tons chauds, je sentais des odeurs de chemins fleuris, j’entendais les rires de ma petite sœur Maëva, je me souvenais de mon premier vélo ; que tout ceci était loin. C’était étrange d’y repenser. Il me semblait que ce passé ne m’appartenait pas vraiment, ou bien qu’il m’avait été volé. Je n’avais plus jamais évoqué ces moments, même en rêve, et j’ignorais qu’ils étaient encore présents dans ma mémoire.
Flore me parla aussi de sa famille et m’affirma que sa mère espérait de tout cœur que je réponde à ce message. Tout à coup je me sentis attaché à cette famille par un lien ancien et j’ai eu l’intuition qu’il fallait que je m’y accroche, car je n’aurais sans doute pas une autre chance de recoller les morceaux de mon histoire.
J’y ai pensé toute la nuit et la journée qui a suivi. En réalité j’étais partagé, d’un côté l’obsession du passé m’avait déjà tourmenté auparavant, et j’avais recherché puis retrouvé mon père, mais cette rencontre m’avait déçu, alors je n’étais plus vraiment sûr de vouloir tenter de nouveau ce genre d’expérience ; d’un autre côté les souvenirs suscités par le message de Flore avaient un goût de miel.
Quand j’étais enfant et que ma vie me semblait trop dure et trop triste, j’avais parfois un sursaut d’espoir qui prenait la forme d’une sensation imprécise, une lumière chaude et bienveillante qui m’envahissait et me réchauffait le cœur. Désormais je compris que cette lumière avait un nom : la Passiflore.
Finalement c’est ce sentiment de bien être qui emporta la décision et je répondis à Flore.
Bientôt nos messages furent plus intimes et j’échangeais avec Emma, la mère de Flore, qui me rappela que je la nommais maman quand je vivais chez elle. Emma avait gardé intacte la mémoire de cette époque. Elle me raconta une foule de détails sur notre vie commune, l’école, les animaux qui étaient aussi mes compagnons de jeux, et surtout de nombreux souvenirs très doux de Maëva.
Maëva, ma petite sœur adorée qui m’avait été enlevée alors que nous vivions chez la folle. Rien que de repenser à cette méchante femme je sens la colère qui se réveille en moi. Ces souvenirs là je ne les ai pas oubliés, et depuis que je suis adulte certains des comportements de cette femme me sont devenus plus clairs.
Elle était la mère de notre famille d’accueil ; dans ce cas précis le terme accueil n’est sans doute pas celui qui convient, mais c’est ainsi que l’on nomme les familles qui prennent en charge des enfants en difficultés.
Quand nous sommes arrivés chez eux j’avais cinq ans et Maëva trois ans, c’était juste après notre séjour chez Emma à la Passiflore.
Le couple était mal assorti ; l’homme était un bon gars, courageux et travailleur, du genre de ceux que je côtoie aujourd’hui dans mon travail. Il était charpentier et aimait son métier.
La femme s’occupait de ses trois enfants ; en réalité les gosses s’élevaient tout seul car elle ne leur accordait pas vraiment d’attention.
Quand le mari était à la maison tout se passait bien, il apportait la paix et sa femme se montrait sous son meilleur jour ; mais dès qu’il avait tourné les talons, la folle qui sommeillait en elle prenait le dessus et alors il fallait filer doux sinon les coups pleuvaient.
Cette femme était caractérielle et elle s’en prenait sans cesse à nous, surtout à Maëva qui en ce temps-là avait un caractère plus affirmé que le mien. Ses propres enfants ne furent pas maltraités, nous fûmes ma sœur et moi, puis plus tard, le nouvel arrivant que l’ASE leur donna après le départ de Maëva, ses seuls souffre-douleurs.
J’ignore comment cela a commencé, car il y a bien eu un début, une première fois, à ce déchaînement de violence. J’ai beau me creuser la mémoire, j’ai perdu le souvenir du moment où tout à basculé. J’imagine que tous ceux qui sont victimes de violences doivent se poser ce genre de question. Qu’est-ce qui a fait qu’on est passé du calme à la tempête ? Il doit bien exister une cause, un évènement déclencheur. Aujourd’hui, même avec le recul, je serai bien incapable de définir ce qui a provoqué les premiers coups.
En revanche je sais qu’au fil du temps, j’ai appris à décoder, dans l’infinie complexité de ma relation avec la folle, l’imperceptible modification de son comportement qui indiquait un prochain accès de violence ; un peu comme le marin aguerri voit se former de légers nuages dans le ciel, sent l’air s’agiter de vibrations inamicales, et voit la houle se former doucement et faire un gros dos boudeur, à tous ces signes le marin pressent le coup de tabac. J’en étais moi aussi arrivé à scruter en permanence l’atmosphère ambiante de cette famille pour prédire l’arrivée de la violence, et je dois dire qu’au fil des années j’étais devenu un expert en la matière.
Je ne sais donc plus comment les premiers coups sont arrivés. Ce dont je me souviens c’est de la brutalité de cette violence ; surtout à l’égard de ma petite sœur Maëva.
Je crois que les souvenirs encore bien vivants que j’ai conservé de ces moments douloureux sont liés à la souffrance de ma sœur.
J’ai en tête des images terribles, Maëva était parfois battue si violemment qu’elle était projetée contre les murs, la folle avait aussi l’habitude de la saisir par les cheveux et de lui secouer la tête, lui en arrachant parfois de pleines poignées. Ma sœur hurlait de douleur et plus elle hurlait plus la folle s’acharnait sur elle. Elle la tirait par l’oreille dès qu’elle refusait d’obéir avec un sourire méchant qui laissait penser qu’elle y prenait peut-être plaisir.
Nous subissions aussi une pression psychologique permanente. La folle nous rabaissait sans cesse, nous n’étions que « des enfants placés » et elle nous faisait bien sentir que ce statut était honteux et nous situait très bas sur l’échelle sociale. Nous en étions arrivés à ressentir la honte de notre condition parce que jour après jour la folle nous la rappelait. Et cette honte finit par nous coller à la peau ; même à l’école, où pourtant nous n’avons jamais subi de discrimination, nous avions le sentiment que notre honte était affichée en gros caractères sur notre front afin que personne n’ignore que nous étions « des enfants placés ».
Nous baignions jour après jour dans cette atmosphère fétide, aussi nous finîmes par croire à cette vérité : la folle avait raison parce qu’elle était toute puissante. Pour tous les autres nous n’étions rien du tout, seulement des enfants encombrants qu’on avait placés, et nous n’avions pas notre place à la table des réjouissances de la vie.
Cette analyse je peux la faire aujourd’hui parce que je suis adulte et que cette période s’éclaire de mon expérience, mais à l’époque je prenais les choses comme elles venaient, les coups et les brimades, sans rien comprendre.
Nous vivions la peur au ventre, Maëva et moi. Seul le temps que nous passions à l’école, ou les moments de présence du mari à la maison nous procuraient l’apaisement.
La folle nous avait averti qu’elle nous donnerait la correction de notre vie si elle apprenait que nous nous étions plaint des coups qu’elle nous infligeait. Lorsqu’un adulte violent tient ce genre de propos à ses victimes, il est sûr de leur silence. Alors nous ne disions rien, pas même à notre mère lorsque nous allions passer quelques jours chez elle.
Je sais qu’elle s’est inquiétée des traces laissées sur le visage de Maëva, mais a-t-elle vraiment fait son possible pour y mettre fin ?
Je crois qu’à ce moment je lui en voulais de nous laisser dans cette terrible situation.
Dès que j’étais chez elle je me libérais du poids du stress et je lui menais la vie dure. Je crois bien que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Je me souviens même d’avoir essayé de mettre le feu dans l’appartement.
Ma mère était fragile et elle fit ce qu’elle a pu, c'est-à-dire peu de chose.
Les retours chez la folle étaient pénibles. Les maux de ventre, les pleurs de Maëva, tout ceci je ne l’ai pas oublié non plus.
Avec le temps les brimades gagnèrent en intensité. J’ai vu un jour la folle plonger la tête de ma sœur dans l’eau de la baignoire à plusieurs reprises pour lui « faire changer de comportement ». La folle tenait ma petite sœur immergée jusqu’à ce qu’elle suffoque puis elle la laissait respirer quelques instants et reprenait la torture. J’étais derrière la porte, alerté par les cris de ma sœur, et je regardais la scène terrorisé ; que pouvais-je faire ? Je n’avais pas encore l’âge de raison et nous étions toujours convaincus que tout ce qui nous arrivait nous l’avions mérité puisque la folle nous le répétait à longueur de journée.
Puis il y eu « la fois de trop ». Ce jour là, la folle était en furie contre ma sœur, et elle la frappa si violemment que Maëva tomba sous les coups et demeura inconsciente pendant quelques instants.
Elle était allongée sur le sol et ne bougeait plus, la folle la secoua, mais ma sœur était comme une poupée de chiffon. J’ai croisé le regard de la femme à cet instant et j’y ai lu un sentiment que je connaissais bien pour l’éprouver quotidiennement et pour le voir aussi très souvent dans les yeux de Maëva : la peur.
Il se produisit alors un déclic en moi qui fit naître une idée parce que je compris que quelque chose d’anormal s’était produit ; cette idée, très vague et très floue à cet instant, allait grandir et se préciser au fil des années qui suivirent : la folle n’avait peut-être pas raison puisque, tout comme moi et ma sœur, elle connaissait la peur. Et si elle n’avait pas raison sa toute-puissance pouvait être remise en cause.
Maëva reprit rapidement ses esprits. La folle ne l’envoya pas à l’école durant plusieurs jours, tant que les traces de coups sur son visage furent trop visibles. Quand ma sœur retourna en classe, les institutrices s’alarmèrent des traces qui n’étaient pas complètement estompées et elles avertirent la gendarmerie du village. Maëva fut conduite le jour même dans un foyer de l’ASE.
Ainsi débuta pour moi une nouvelle vie ; j’étais désormais un enfant placé et solitaire. Je n’avais plus ma petite sœur avec moi, ma Maëva dont je me sentais responsable.
Je posais des questions auxquelles personne ne répondait : où était-elle ? Que lui avait-on fait ? Durant de longs jours, je n’appris rien.
La folle semblait s’être un peu calmée et me ficha la paix pendant ces moments troublés. A l’école on me dit seulement que Maëva allait bien et que je ne devais pas m’inquiéter, mais personne ne voulut répondre à ma question essentielle : Quand reviendrait-elle ?
Lorsque je revis ma mère pour la première fois après le départ de Maëva, elle me donna plus d’explications, mais elle n’avait pas encore eu la permission d’aller la voir dans le foyer où les services sociaux l’avaient placée.
J’ai demandé si je pouvais moi aussi la rejoindre dans ce foyer mais la question resta sans réponse.
Il fallut donc apprendre à vivre sans Maëva.
A ce moment de notre vie commune, elle était la seule personne qui m’était proche et désormais je ressentais durement la solitude ; ma sœur me manquait terriblement. Mais ce que je ne savais pas encore c’est que cette situation perdurerait longtemps.
Hormis les week-ends, toutes les deux ou trois semaines, que nous passions chez notre mère, Maëva et moi n’avons plus jamais vécu sous le même toit durant notre enfance. C’est ceci que je reproche le plus aux services sociaux, nous avoir séparés est une faute que je ne leur pardonne toujours pas.
Et puis la vie a pris le dessus. J’avais six ans, j’allais à l’école, je vivais dans une famille d’accueil peu accueillante, mais je ne pouvais rien faire pour changer cette situation, alors je m’en suis accommodé.
J’ai développé une stratégie pour limiter les accès de fureur de la folle ; je réagissais promptement à ses ordres, je tentais du mieux possible de ne pas enfreindre ses interdits, et ainsi je m’évitais des moments difficiles.
Mon esprit devint aussi plus vif à voir les signes annonciateurs des tempêtes, et lorsque j’apercevais un petit nuage et que l’air s’agitait de vibrations inamicales, je m’éclipsais aussitôt.
Bien sûr je prenais une raclée de temps à autre, histoire de me rappeler que je n’étais qu’un « enfant placé » ; les causes les plus fréquentes étaient dues à mon statut d'aîné de la famille, et lorsque les petits faisaient des bêtises je prenais souvent pour eux.
Le soir, dès que j’en avais la possibilité, car le couvre-feu de neuf heures était immuable, j’aimais observer les étoiles. Je voyais en elles toute la beauté d’un monde qui m’était inaccessible.
Je fixais les plus brillantes, cherchant celle qui me semblait la plus étincelante, et, comme sur la planète du Petit Prince, j’imaginais un petit garçon de mon âge, avec mes traits, mais heureux tout autant que j’étais malheureux.
Parfois d’autres enfants le rejoignaient, rieurs et insouciants et s’ébattaient avec lui dans des prés fleuris éclatants de couleurs.
Moi, je flottais au-dessus d’eux, partagé entre le désir de leur compagnie, et celui de rester sur terre à contempler mon étoile.
A la télévision, j’avais entendu parler des extra-terrestres qui peuplaient d’autres planètes. Je pensais qu’elles ne pouvaient abriter que des petits princes aimés des leurs.
Je ne voulais pas être un prince, simplement un enfant normal avec une vie sereine au sein d’une famille.
J’étais certain que ceux qui occupaient ces planètes lointaines menaient là-bas une enfance paradisiaque. Libres de leurs mouvements, choyés et câlinés le soir avant de s’endormir, ne connaissant pas l’humiliation des coups, ni les privations multiples dont j’étais victime.
Cet astre scintillant que j’admirais et dont la source lumineuse représentait pour moi le rêve de l’amour inaccessible, personne ne pouvait me le prendre. Si le ciel était commun à tous, alors les étoiles qui le peuplaient étaient assez nombreuses pour que chacun ait la sienne.
J’avais appris que l’expression “être né sous une bonne étoile” relève de l’influence qu’on leur attribue à notre destinée ; alors je scrutais inlassablement le firmament, espérant trouver la mienne. Ma bonne étoile ! Celle qui m’apporterait l’amour, ce bonheur suprême auquel j’aspirais et qui ne m’avait été accordé que dans une famille de passage dont je commençais à perdre le souvenir. Cet amour, je désespérais de ne jamais le recevoir sur cette terre.
Si là-haut, perdu dans l’espace, il y avait des vies d’enfants douces et joyeuses, pourquoi la mienne ici était-elle aussi misérable ? Pourquoi étais-je privé de tendresse ? Oublié de ma mère qui avait déménagé, s’éloignant ainsi un peu plus de moi, sans père et doté d’une grand-mère maternelle qui nous ignorait ma sœur Maëva, mon petit frère et moi. Pourquoi n’étions-nous pas tous réunis ?
Pourquoi ? J’étais trop jeune pour comprendre une situation qui m’échappait totalement, mais assez intelligent pour savoir que les adultes qui m’entouraient n’étaient pas honnêtes.
Sur cette terre hostile, mes interrogations n’obtenaient jamais de réponses et je ne faisais plus confiance à personne.
Je recherchais en vain des attaches et un port où amarrer mon cœur, et, dans mes vagabondages spirituels, j’avais fini par conclure que le paradis était dans les étoiles.
Je voulais simplement que quelqu’un m’aime... Alors, dans mon lit, en silence, je priais mon étoile pour qu’elle m’enlève à cette famille, qu’elle me ramène l’affection de ma mère et qu’enfin je vive auprès d’elle avec mes frères et sœurs.
Puis, ravalant mes larmes dans cette chambre que je partageais avec des garçons qui m’étaient étrangers, je m’évadais en m’endormant, rêvant quelquefois que je m’envolais dans l’immensité de l’univers à la recherche de ma bonne étoile...
III
Les années passèrent ainsi aux rythmes des taloches et des brimades. Bientôt j'eus dix ans.
Désormais je voyais les choses différemment. Ce que j’apprenais en classe et au contact de mes camarades me permettait d’entrevoir qu’une autre vie était possible. Je connaissais maintenant la différence entre le bien et le mal, et je n’avais plus une confiance absolue en la parole des adultes.
Chez ma mère j’étais intenable, elle n’avait plus aucune autorité sur moi et je commençais à acquérir une forme d’indépendance intellectuelle.
La folle me frappait encore, mais tout doucement je commençais à lui tenir tête et je sentais qu’elle se méfait.
Elle devait se rendre compte que désormais ma parole était libre et qu’il valait mieux qu’elle ne dépasse pas certaines limites.
Je m’habituais à cette vie sans plaisirs ni joie à l’opposé de celle de mes camarades de classes qui étaient sans aucun doute bien plus heureux que moi, mais que pouvais-je faire pour changer ma propre vie ? Ne plus voir la folle, voilà ce que je souhaitais plus que tout.
Lorsque j’en eu l’opportunité, j’en parlais à mon assistant social référent, mais il me fit comprendre que ce n’était pas aussi simple de changer de famille d’accueil ou d’aller en foyer, et qu’il fallait pour cela une bonne raison.
Les coups n’étaient-ils pas une bonne raison ? Il est vrai qu’à cette période j’encaissais mieux et surtout j’esquivais d’avantage que lorsque j’étais petit, alors je n’avais pas de traces susceptibles de justifier mon déplacement.
Il me fallait trouver autre chose pour contrer la folle qui ne souhaitait pas mon départ, car cela signifiait pour elle la fin d’un revenu substantiel ; je l’avais entendu en parler avec son mari. J’étais pour elle une source de revenus.
Il fallut attendre encore plusieurs mois pour qu’enfin un évènement inattendu m’apporte une solution et le moyen de la faire plier.
IV
Le mari de la folle qui était charpentier dut s’absenter de longs mois à cause d’un chantier à l’étranger. Durant cette période, la folle visitait régulièrement son beau-père, le père de son mari, qui vivait non loin de là. Elle s’y rendait souvent les mercredis après-midi et nous emmenait avec elle, car ses enfants aimaient jouer dans le pré attenant à la maison qui servait d’entrepôt à de vieilles caravanes.
Nous jouions à cache-cache dans cet enchevêtrement de vieilleries qui nous offraient une multitude de cachettes. Pendant ce temps là, la folle et le beau-père restaient dans la maison.
Un jour il y eu un petit accident ; l’un des gosses passa le pied à travers le plancher pourri d’une caravane et se blessa salement la jambe. Il hurlait comme un veau, et quand je m’approchais je vis qu’il était coincé ; sa jambe était prise jusqu’en haut de la cuisse et était toute écorchée.
Sentant déjà la raclée que j’allais prendre pour ne pas l’avoir surveillé de près, je courus vers la maison pour prévenir la folle et éviter ainsi une deuxième raclée pour ne pas l’avoir prévenue à temps.
J’entrais dans la maison, mais il n’y avait personne au rez-de-chaussée. Je montais les escaliers à toute vitesse et j’entrais sans crier gare dans la chambre du premier. Elle était plongée dans la pénombre, mais je pus tout de même distinguer deux silhouettes sous les draps qui s’agitèrent à mon arrivée. La grosse voix du beau-père me cria de ressortir et de fermer la porte ; ce que je fis prestement.
Un moment plus tard, la folle sortie comme une furie, elle avait enfilé en hâte son chemisier, je le compris aux boutons qui étaient attachés de travers, ses cheveux étaient ébouriffés et ses yeux sortaient de leurs orbites. En général lorsqu’elle prenait cet air ahuri cela signifiait que les coups allaient pleuvoir, mais je réagis plus vite et lui expliquais en deux mots la situation.
Le soir, après le repas elle me prit à part et me questionna sur ce que j’avais vu dans la chambre. Je répondis qu’il faisait trop sombre et que je n’avais rien vu, mais je compris qu’elle ne me croyait pas. Elle scrutait mes yeux cherchant à découvrir l’indice qui me trahirait et provoquerait son courroux. Mais je ne bronchais pas. Alors d’une voix que je ne lui connaissais pas elle m’affirma que si jamais je répétais à quiconque ce que j’avais vu dans la chambre, elle me ferait passer le plus mauvais moment de ma vie ; je vis alors dans son regard ce que j’avais déjà observé quelques années auparavant le jour où elle avait tant frappé ma sœur, je vis la peur dans ses yeux.
Désormais je compris que les rôles s’inversaient et que le temps où je devais plier sous la méchanceté de cette femme était révolu. J’avais maintenant un pouvoir sur elle, et je comptais bien m’en servir pour m’émanciper. J’ignorais comment, ni quand, mais je savais que c’était maintenant à ma portée.
L’espoir qui m’avait fait défaut si longtemps faisait soudain son apparition, et cela changeait considérablement le cours de ma vie.
V
Près d’un an plus tard, j’étais dans ma treizième année et je vivais toujours chez la folle.
Elle me laissait un peu plus tranquille depuis quelques temps ; elle avait semble-t-il renoncé à me frapper, sans doute parce que j’étais trop grand, mais aussi à cause de ce que je savais.
Cependant l’atmosphère restait tendue à chaque départ du mari. Les gosses du couple grandissaient et faisaient bêtises sur bêtises et à chaque fois la folle me criait dessus prétextant que je ne les surveillais pas ou bien que j’avais une mauvaise influence sur eux, enfin toute occasion était bonne pour se défouler sur sa tête de turc favorite.
Mais je ne supportais plus ses brimades incessantes et je n’avais plus qu’un seul désir : fuir cette maison.
C’est ainsi que lors d’une de ces disputes où la folle déversait sur moi son flot de méchancetés, je me rebellais.
D’ordinaire quand elle commençait à crier je baissais les yeux et faisais profil bas ; cette posture de soumission avait généralement un effet calmant sur la femme et j’évitais ainsi les coups. Mais cette fois-ci mon exaspération était à son comble et lorsqu’elle s’en prit à moi je la défiais du regard.
La réaction ne se fit pas attendre, et une première claque me fit chanceler ; pourtant je ne changeais pas d’attitude et je persistais à la fixer droit dans les yeux sans ciller. Une deuxième claque puis une autre ne me firent pas broncher. Mes joues me chauffaient terriblement, mais je ne voulais céder à aucun prix.
La folle semblait stupéfaite ; ses yeux étaient écarquillés et son teint virait au rouge ce qui était plutôt de mauvais augure. Je savais que je jouais gros, cette femme était encore physiquement plus forte que moi et elle était capable de me faire vraiment mal, mais je m’en fichais ; quelque chose en moi avait changé et je n’étais plus d’humeur à en supporter d’avantage. Il fallait que cela cesse dès aujourd’hui.
Alors je la menaçais, je lui dis d’un ton calme et assuré que si elle continuait à me frapper je raconterai ce que j’avais vu dans la chambre.
Loin de la calmer mes paroles déclenchèrent sa fureur, elle me frappa à tour de bras en criant qu’elle allait me faire passer l’envie de dire des mensonges ; je me protégeais comme je le pouvais, mais curieusement je ne tentais pas de fuir parce qu’un plan se dessinait dans mon esprit : si je la laissais me marquer le visage, j’aurais enfin une raison de demander mon retrait de cette famille.
La folle me frappait maintenant à coup de poings et de pieds et j’encaissais sans broncher, je ne sentais plus ses coups tant j’étais tendu vers mon but, je voulais la pousser à la faute.
C’était très étrange, j’eus l’impression de regarder la scène depuis un autre point de vue ; je voyais cette femme frapper un adolescent, il avait mes traits mais ce n’était pas moi. J’étais déjà ailleurs convaincu qu’enfin je l’avais en mon pouvoir. La folle enrageait, écumait, une bave blanchâtre s’échappait de la commissure de ses lèvres, elle ressemblait à une bête enragée.
Je pensais par-devers moi, « frappe vieille folle, frappe, tu ne m’atteins plus, je suis ton maître désormais ».
Soudain un coup plus fort que les autres me projeta sur le coin d’un meuble et je m’affaissais, étourdi ; ma tête était douloureuse et je sentis mon sang chaud couler le long de mes tempes.
La folle cessa de frapper, elle regardait hébétée le liquide rouge qui tâchait maintenant le sol à grosses gouttes.
Je ne sais pas si elle comprit à cet instant que je l’avais possédée, mais elle en fut persuadée quelques temps plus tard, lorsque le médecin qui recousit ma plaie lui indiqua qu’il devait signaler cette maltraitance. C’est alors qu’elle croisa mon regard victorieux.
Dès le lendemain les services de l’ASE me conduisirent dans un foyer. Ainsi prirent fin ces années de souffrances.
VI
Une nouvelle vie débuta pour moi. Après quelques temps au foyer je fus accueilli par un couple d’agriculteurs. Ils étaient gentils et j’aimais le cadre de vie que je trouvais chez eux à la ferme parmi les animaux.
Cependant je n’étais plus un enfant facile ; c’était le début de l’adolescence et avec elle arrivèrent des comportements complexes.
Toute la rancœur qu’avaient nourrie mes années chez la folle s’exprimait parfois violemment sans que je n’y puisse rien.
Mes carences affectives me faisaient prendre des chemins où le paradoxe l’emportait sur la raison.
Pour la première fois depuis la Passiflore sans doute, j’étais un enfant bien traité, mais je ne rendais pas la gentillesse qu’on me témoignait ; au contraire je devenais insupportable.
Je demeurais chez eux quelques années puis alors que rien ne le laissait prévoir, ma mère décida de me reprendre avec elle. J’avais alors presque seize ans. Mais cette période de retrouvailles ne dura pas ; j’étais toujours aussi difficile à vivre et elle jeta l’éponge. Après quelques temps, je me retrouvais de nouveau en foyer.
Cette nouvelle période fut l’une des plus profitables de ma jeunesse. Je trouvais des éducateurs compétents et à mon écoute, qui m’encouragèrent et me donnèrent le goût d’apprendre. Le jeune adulte que je devenais entrevoyait enfin qu’une vie heureuse était à sa portée.
Plus tard, après avoir quitté le foyer, j’ai enfin trouvé l’équilibre. Aujourd’hui j’ai un travail, une compagne, et ma petite sœur Maëva près de moi.
Et puis désormais j’ai une nouvelle famille, celle que j’ai retrouvée après de si longues années : la famille d’Emma, ma mère d’adoption.
Que de chemin parcouru depuis la Passiflore, depuis ce temps heureux qui nous a été volé. Chacun a suivi sa route : ma sœur et moi chez la folle, Emma qui a vainement tenté de nous arracher à ses mains, puis Maëva de son côté et moi du mien, et enfin notre petit frère Lorenzo, de neuf ans mon cadet, qui a rejoint nos chemins de misère.
La route fut longue pour nous tous ; nous avons fait un long détour, un très long détour, mais nous sommes de nouveau réunis. Qui sait si la bonne fortune nous permettra un jour de nous retrouver tous ensemble comme à la belle époque de la Passiflore.
MAËVA
VII
Lorsque Benoît me parla de la famille qui nous avait accueillis enfants, j’avoue que je n’en avais aucun souvenir.
Mon frère se souvenait du piano et de la petite fille qui en jouait, j’appris plus tard qu’il s’agissait de Flore, mais moi j’avais beau me creuser la mémoire rien ne me revenait.
J’étais bien trop jeune à l’époque pour me souvenir de quoi que ce soit. On dit que les souvenirs les plus lointains ne peuvent guère remonter au-delà de l’âge de quatre ou cinq ans, j’étais bien plus jeune à l’époque, alors la Passiflore est trop loin dans le temps. Une seule image m’apparut douce à l’idée et claire dans ma mémoire, un bassin ou nageaient des poissons rouges. J’étais assise sur une pierre et je les regardais tournoyer autour d’une source qui coulait en chantant près de moi.
Néanmoins je fus curieuse d’apprendre comment se sont déroulées mes premières années et la mémoire de Emma m’a beaucoup apporté pour combler les lacunes de mon passé.
Je me nomme Maëva, je sais que ce prénom signifie « bienvenue » dans la langue tahitienne, mais il semble qu’il ne m’ait pas porté chance au tout début de mon existence.
Aujourd’hui je suis une jeune femme adulte qui croque la vie à pleines dents. Rien n’est facile bien sûr, mais j’ai désormais des armes pour affronter le quotidien et je ne m’en sors pas trop mal.
Avec mon frère Benoît nous reformons la famille qui nous a tant manquée dans notre enfance. Mon frère et sa compagne Jessica, m’ont aménagé une chambre dans leur maison et je suis bien chez eux.
Parfois notre petit frère, Lorenzo, qui est de sept ans mon cadet, vient aussi nous rejoindre.
J’ai vécu plusieurs années avec lui dans deux familles d’accueil différentes ; la vie a été dure pour lui aussi, et il n’est pas encore tiré d’affaire puisqu’il est mineur et donc toujours sous la tutelle de l’ASE.
Lorenzo a aussi été maltraité ; le chef de la famille qui nous accueillait était violent et battait souvent mon petit frère.
Lorsqu’on est soumis enfant à ce genre de situation on n’envisage pas qu’une autre existence soit possible. Aujourd’hui avec le recul, je me rends compte que toute ma fratrie n’a subi que violence et humiliation dans la jeunesse.
Heureusement tout ceci est derrière nous désormais.
Lorsque j’ai appris la maltraitance dont je fus victime très jeune, chez celle que mon frère nomme la folle, et aussi le combat d’Emma pour tenter de nous sortir des griffes de cette femme, j’ai été émue.
J’ignorais que j’avais été l’objet de tant d’enjeux et aussi d’amour de la part d’une famille qui nous avait durant plusieurs mois traités comme les siens, avant que l’on nous jette, mon frère et moi, en enfer.
J’ignorais tout ceci et cette découverte me réconciliait en quelque sorte avec mon passé.
Adolescente, je m’étais forgé la conviction que l’amour et l’affection n’étaient pas pour moi.
J’allais solitaire, mais je trouvais mon équilibre dans les études où je réussissais bien et aussi dans la pratique de la course à pied.
J’apprécie ce sport où l’on est face à soi-même et où le dépassement vient de l’intérieur ; j’étais plutôt douée et j’ai gagné de nombreuses courses.
J’ai un petit avantage qui me permettait réussir, une force que beaucoup ne possèdent pas ; cette force me permet d’aller bien au-delà de mes limites physiques. Je sais m’isoler de la douleur, faire taire les supplications de mon corps ; il me suffit pour cela de me retrancher à l’intérieur de moi-même et tout m’est alors indifférent. Pour la course, cette faculté est un avantage considérable. Je me suis longtemps interrogée sur son origine et c’est en écoutant Emma me raconter les évènements du passé que je crois en comprendre la cause.
Je m’imagine enfant, sans défense, subissant la méchanceté quotidienne de la folle qui me frappait, m’arrachait des poignées de cheveux, me plongeait la tête sous l’eau.
Je pense que mon inconscient a mis au point une stratégie pour me protéger, puisque personne semble-t-il ne prenait ma défense, et j’ai dû apprendre à m’isoler intérieurement pour ne plus ressentir les coups.
C’est probablement de cette époque douloureuse que me vient cette faculté de bloquer les signaux de mon corps et de me comporter dans l’effort comme si je ne ressentais rien. Finalement c’est la seule chose positive qui me fut donnée durant mon enfance troublée. Cette force de caractère m’a permis de devenir pompier volontaire ; en plus de mon travail, j’exerce cette activité que j’aime. Benoît m’a suivi dans cette voie, il est dans la même caserne que moi. J’étais bonne élève, cependant j’ai fini par arrêter mes études pour subvenir à mes besoins, et je suis autonome à présent.
Je ris intérieurement en pensant que cette folle ne nous aura pas soumis, ni Benoît, ni moi ; la violence n’aura pas servi ses intérêts. C’est sans doute la leçon qu’il faut tirer de cette époque.
Aujourd’hui j’ai enfin trouvé l’équilibre et je suis prête pour débuter ma vraie vie. Je tiens désormais mon destin entre mes propres mains, et je ne laisserais plus jamais personne décider pour moi.
“Les quelques grandes choses qui importent dans la vie, on doit garder les yeux fixés sur elles, on peut laisser tomber sans crainte tout le reste. Et ces grandes choses, on les retrouve partout, il faut apprendre à les redécouvrir sans cesse en soi pour s'en renouveler.” Etty Hillesum (une vie bouleversée)
VIII
Ce n’est pas si facile de retrouver des êtres chers après de si longues années de séparation.
La dernière fois que je les avais vus, Benoît et Maëva étaient enfants, mais ils étaient devenus de jeunes adultes.
Après de longs mois d’échanges nous avons décidés de nous voir ; il y a toujours un moment où l’on sent que cela est possible, c’est une sorte de nécessité irrépressible. Les êtres humains ont besoin de contacts physiques.
La nuit qui a précédé cette rencontre j’ai eu du mal à trouver le sommeil. J’étais perturbée, je craignais que quelque chose ne fasse capoter notre relation qui avait pris un si bon chemin.
Nous avions échangé de nombreuses photos pour pouvoir nous reconnaitre sans trop de surprise, et nous avions maintes fois conversé au téléphone, mais tout ceci était virtuel. Il restait à affronter la rigueur de la réalité.
Benoît m’avait donné rendez-vous près du vieux moulin à huile, vestige historique de leur village provençal. Nous avions convenu de passer l’après midi chez lui en compagnie de Maëva.
En patientant près du vieux moulin je ne pouvais m’empêcher de repenser à toute cette histoire ; aux sentiments mêlés de joie et de peine, mais surtout à l’amour qui fut le liant de cette aventure.
Je me souvenais des recommandations des services sociaux qui nous encourageaient à ne pas nous attacher aux enfants qu’on nous confiait et je m’interrogeais sur leur bien-fondé. Comment peut-on demander à une femme de ne pas éprouver d’amour pour un petit enfant ? Je crois que les services sociaux n’avaient rien compris à la nature humaine.
Aujourd’hui, Benoît, Maëva, et moi-même, étions les exemples de ce que l’amour peut engendrer de bon, car sans la puissance de ce sentiment nous ne serions pas sur le point de nous retrouver, comme une famille, dix-sept ans après notre involontaire séparation.
L’amour avait vaincu l’ASE et ses règlements absurdes, et reléguait leurs conseils aux rangs des inepties les plus stupides.
J’observais le vieux moulin ; il avait servi autrefois à broyer des olives ; le parcours des enfants n’en était guère éloigné. Ils avaient été broyés, eux aussi, par le rouleau compresseur de l’administration, et ils auraient pu ne jamais s’en remettre. Mais c’était sans compter sur l’amour qui existait entre eux, et qui les a maintenus dans le droit chemin envers et contre tout. On leur a fait subir le pire, mais de ce pire est sorti le meilleur, comme de l’olive broyée vient la meilleure huile.
Je connaissais leur nouvelle vie dans ses moindres détails et je savais qu’aujourd’hui ils vivaient heureux. Benoît avait enfin trouvé l’équilibre auprès de sa nouvelle compagne, et Maëva vivait sous leur toit. Le frère et la sœur était enfin réunis, et ils avaient tous deux besoin d’une période de vie commune pour conjurer le mal qu’on leur avait fait enfants en les séparant. Ils tentaient aussi de faire venir chez eux leur petit frère Lorenzo qui était encore mineur et donc sous tutelle des services sociaux. Mais cet enfant était aussi l’objet d’enjeu de leur mère qui voyait d’un mauvais œil cette fratrie se recomposer sans son aval.
Rien n’était simple, mais ils étaient sur la bonne voie, et désormais ils pouvaient compter sur mon aide. Déjà le projet de témoignage que j’ai écrit pour eux leur avait fait du bien, les réconciliant d’une certaine manière avec le passé.
Benoît rangea sa voiture près de la mienne. Maëva était à ses côtés. Ils étaient radieux. Nous demeurâmes quelques instants étonnés de nous retrouver si simplement, puis nous tombâmes dans les bras les uns des autres.
En embrassant ces enfants qui étaient maintenant de beaux jeunes adultes, je pensais que tout était accompli. Ceux qui n’auraient jamais dû être séparés était de nouveau réunis ; c’était là toute la force de l’amour, et il avait tenu ses promesses. La boucle était enfin bouclée.
Il reste maintenant à écrire la fin de cette histoire, mais elle ne m’appartient plus, désormais c’est celle de Benoît et de Maëva. Quant à moi je sais déjà ce que cette page de ma vie représente, et je crois pouvoir affirmer, en me retournant et en contemplant le long chemin parcouru depuis la Passiflore, en regardant avec tendresse l’amour qui est né de ma rencontre avec les enfants, et le lien fort qui nous unit à présent, je crois pouvoir affirmer avec fierté, que c’est l’une des plus belles pages de ma vie.
Fin
REMERCIEMENTS
A celles et ceux qui m’ont aidé dans la réalisation de ce projet, à mes filles, à mon homme, à Jessica, à Laurence, ainsi qu’à toutes les fleurs qui ont parsemé mon chemin : merci.
Et bien sûr, à Carlos K, sans qui ce livre n’aurait jamais vu le jour : que ses dons de conteur, comme la beauté des mots de Laurence Witko, soient un jour reconnus.
EMMA BICHAU
Le pouvoir du don...
" Si vous avez un talent, donnez-le. Il deviendra alors véritablement vôtre."
Daphné Rose Kingma
Les talents cachés... on ne les apprécie toujours que lorsqu'ils nous sont révélés : le secret et la discrétion ont leurs limites de séduction...
C'est en donnant qu'on reçoit en retour... aussi ne faut-il pas craindre d'être dépossédé de sa richesse intérieure en la répandant sur le monde : la reconnaissance de notre présent nous revient comme un boomerang revient à son point d'origine...
Ce ne sont pas les notes griffonnées sur une portée qui font le musicien, mais bien la musique qu'il nous est donnée d'entendre... tout comme les mots ne font un écrivain que s'ils sont lus... ou qu'un acteur ne devient interprète que lorsqu'il se glisse dans un rôle à jouer...
Donner dans le but de recevoir, prive de la pureté de l'art et limite le talent, parce qu'à trop s'orienter vers le but, on en néglige les moyens...
Pour sonner vrai, il faut donner pour donner, sans focaliser sur le retour...
Donner un talent, c'est l'afficher en place publique au jugement et à l'appréciation de tous... c'est risquer la déception, la jalousie et surmonter crainte, pudeur et réserve...
Mais c'est aussi permettre à autrui de venir à la rencontre de sa singularité et de sa sensibilité... s'ouvrir au monde sans pourtant s'y offrir en toute vulnérabilité...Laurence Witko


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F7%2F576529.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F20%2F73%2F670430%2F60313924_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F87%2F670430%2F51170654_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F41%2F670430%2F47715156_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F17%2F670430%2F46643293_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F37%2F98%2F670430%2F46445425_o.jpg)

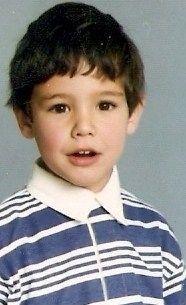



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F67%2F670430%2F127625709_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F26%2F670430%2F104242471_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F77%2F670430%2F119692142_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F57%2F51%2F670430%2F119692039_o.jpg)